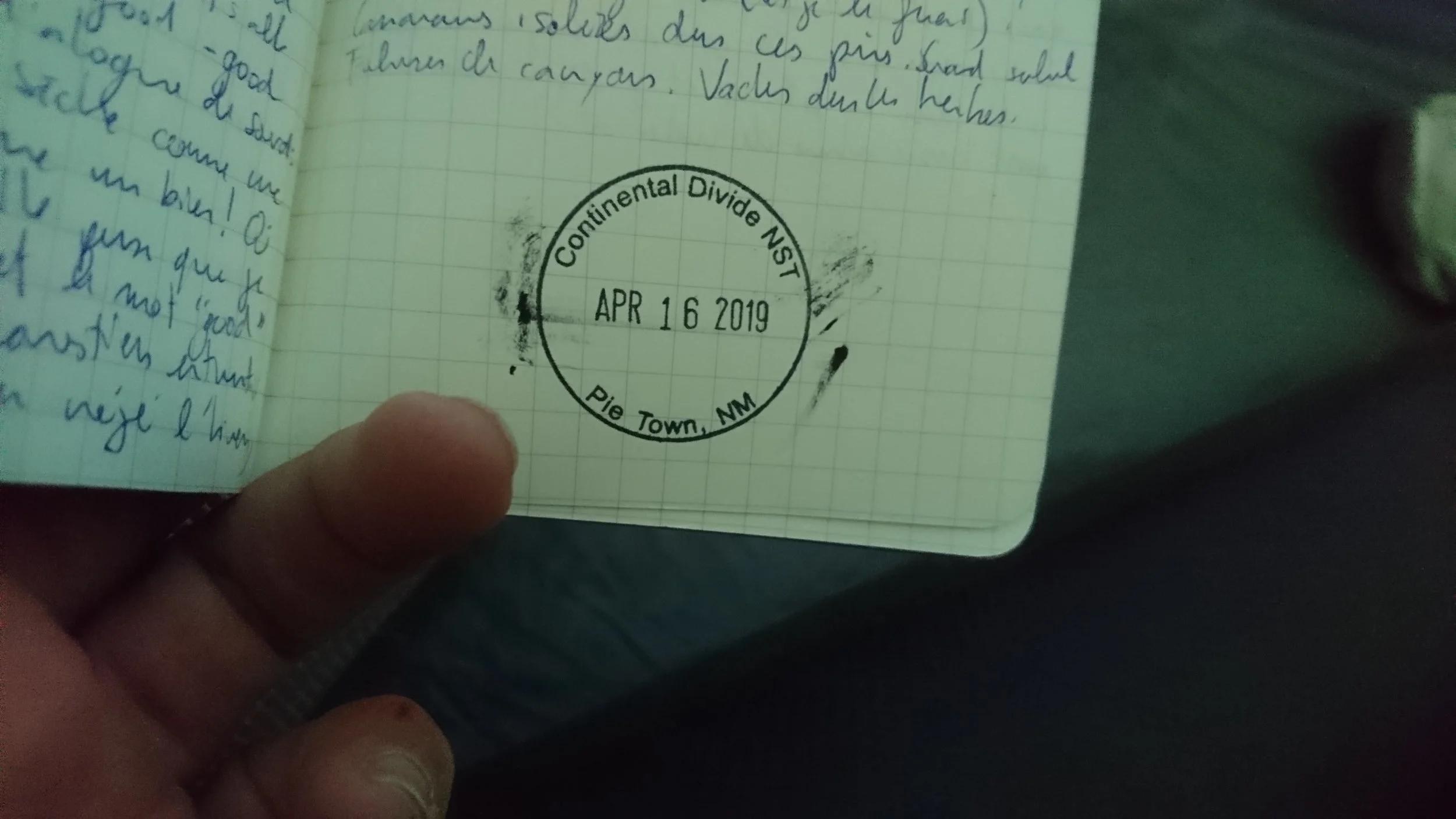Floride - Californie, mars à mai 2019
En 2018 et 2019, je passais plus d’un an à vélo, à partir pour quelques mois puis retourner chez moi pour ne finalement souhaiter que fuir à nouveau. Je payerais cher lorsque j’y mis un terme cette fuite en avant qui se renouvelait sans cesse. Mais dans ces moments, je ne pensais qu’à ma fureur.
Voici le carnet de mon voyage du printemps 2019, de la Floride à la Californie par le Sud des USA, révisé en 2023. En le retravaillant, j’y ai retrouvé ce moi plus jeune, obsédée par la recherche de quelque chose de plus grand. J’étais parfois aveugle mais, souvent, j’observais avec une justesse qui maintenant me surprend, car nous sommes rapides à trop facilement accepter ou renier les personnes que nous fûmes ; et il semblerait que ma tendance à me mésestimer vaut également lorsque je pense à mes moi passés, trop hâtivement sûre qu’ils n’ont rien à m’offrir ou m’apprendre.
Mars 2019, j’ai 26 ans, l’âge juste avant celui où l’on frappe un mur à pleine force et dans la blessure y perd notre première jeunesse.
Après un mois et demi à Paris, je m’installais dans une langueur détestable, et cultivais des plaisirs sans but. J’étais revenue de longs voyages, mais je n’en aimais toujours pas le retour au quotidien (car rien ne m’y attendait). Lors d’une soirée, presque anecdotiquement dans le milieu d’une phrase, Damien me demanda quand et où serait ma prochaine aventure. Je ne savais pas. Mais si bien que l’on me définissait maintenant par mes voyages à vélo (et qu’on me présentait aux autres ainsi : « Voici Zoé, elle fait beaucoup de vélo »), j’avais commencé, moi aussi, à y puiser un sens profond et à y jeter tout mon désir d'auto-définition. Le lendemain, je prenais un billet. Je décidais de continuer cette fuite en avant qui conduisait ma vie comme un char de triomphe, et l’on me jetait des lauriers, et j’allais alors à bride abattue, convaincue que loin au-devant se trouvait mon destin.
14 mars
Les parents m’emmènent à l’aéroport, avec leurs masques inquiets auxquels je me suis habitué et qui me provoquent moins de remords qu’avant. Les silences parlent de bien de mots qui ne sont jamais dits dans la famille, et j’y ai souvent entendu de la peine et un peu de reproche. Maman attend avec moi à l’enregistrement. J’ai commencé à prendre le tour de main quant à l’emballage de mon vélo. Il est emmitouflé de papier bulle et de protections de plastique dans sa boite afin d’arriver sans dommage. J'atterris à Orlando le soir. Après l'atterrissage, le pilote annonce « Welcome to the most wonderful place in the world » dans une drôle de voix traînante, et je ne comprends pas tout de suite. Puis je remarque chez d'autres passagers, qui se lèvent lors du roulage pour récupérer leurs bagages, un détail qui n’avait, tout durant le long vol, pas attiré mon attention. Beaucoup portent des t-shirts Disney, et des enfants arborent des oreilles de Mickey. Ce long cours vole toute l’année, à des tarifs bon marché, pour faire navette entre l’Europe et Disneyland Florida.
Je prends la navette de l’hôtel avec mon vélo encore emballé, tel que je l’avais prévu. Il fait déjà nuit lorsque j'atterris. Je monte mon vélo dans ma très grande chambre, qui a même un espace de salon séparé.
15 mars
Les oiseaux chantent et l’air est très humide. La chaleur devient dure à supporter dans la moiteur de l’après-midi. Je passe au nord d’Orlando à REI, afin de récupérer une commande faite la semaine précédente dans mon appartement parisien : une sacoche de cadre pour mon Salsa Warbird. J’ai à peine roulé sur ce vélo depuis son achat, pas plus de 200 kilomètres, il ne m’est pas encore familier. J’achète également des porte-bidons neufs pour remplacer ceux d’acier dont l’usure a fait craquer les soudures. J’ai placé ma tente à l’avant de ma sacoche de cintre. Elle s’y tient bien, protégée par la sorte de capot qui la couvre. La sacoche de cadre (ma première) est bien pratique et je la remplis rapidement d’outils, de snacks et de ma veste de pluie. En Nouvelle-Zélande, il y a quelques mois, j’observais Tom qui avait sa montre Garmin pour traquer son périple. J’achetais à mon retour à Paris un bracelet Vivosport et, pour la première fois, je voyais quand j’atteignais un point de WiFi me permettant d’uploader les enregistrements, le chemin que j’avais fait sur une carte. Jusque-là, j’avais retracé au feutre et de mémoire, à chaque retour, mon chemin sur un ancien atlas de 1992 qui était la bible de mes voyages. Je gardais longtemps les noms des villes que je traversais en mémoire. Même une année après, je pouvais les relier avec facilité sur une carte, un par un, en me souvenant des tournants, des vallées, des fourches que j’avais empruntés. Désormais, je pourrai voir sur Strava les souvenirs des dizaines de milliers de kilomètres que je ferai, encore et encore, étalés sur leur grande carte du monde. Le bracelet n’enregistre que sept ou huit heures, faisant que les longues journées sur la route finissent toutes abruptement au milieu de nulle part, avant de recommencer le lendemain des dizaines de kilomètres à l’ouest. Chaque jour, j’irai à l’ouest. Je vois des paons domestiques dans un jardin le matin, et une tortue (« snapper ») de terre sur le bas-côté de la route.
Je ne m'arrête pour la première fois qu’après être sortie tout à fait d’Orlando, dans la Seminole Forest. C’est une réserve naturelle, plate comme toute la Floride, faite de grands pins espacés sur un sol sableux. Je suis des routes de terre, puis emprunte la Florida Trail. Je m’amuse sur les sentiers très roulants, formant de petites cuvettes étroites d’aiguilles de pin bien tassées, qui lancent ma roue sur la bonne voie à chaque tournant comme une balle de pin-ball. Très vite, j’atteins des sections qui sont interdites aux vélos par des panneaux. Je tente de trouver des alternatives. Je rejoins des routes de sable où je m’enfonce, qui m’épuisent et me font surchauffer sous le soleil. Je dois m’arrêter à l’ombre plusieurs fois et marcher lorsque le sable se fait trop dense. Mon gravel fait pâle mine à devoir être poussé ainsi. Il y a des fourmis rouges qui vivent dans le sable, et je prends garde à ne pas les déranger.
Le soir, je suis dans l'Ocala National Forest. La chaleur m’a épuisé, ainsi que mon errance à la recherche d’une route ni trop en sable, ni interdite aux vélos, et je plante ma tente à la lisière d’une grande clairière de plusieurs centaines de mètres de côté, carrelée de petits arbres nouvellement plantés. Mon campement est placé sur une ancienne route, après un arbre abattu. Je suis ainsi assurée que personne ne viendra dans la nuit d’où je viens, et il n’y a aucune trace de véhicules venant de l’autre côté non plus. Je vois sur ma carte qu’il y a une base militaire, peu loin au-delà de la clairière d’arbrisseaux. Je n’ai pas fait plus de 120 kilomètres, mais je suis fatiguée et je me couche au crépuscule (encore bien tôt dans la fin de l’hiver). Les cigales sont déjà sorties de leur dormance, et leur murmure monte avec la nuit. Alors que je m’endors doucement, je vois une lumière diffuse jaunir un pan de ma tente. J’ouvre les yeux et, immobile, j’écoute. Je sens mon cœur accélérer tandis que je me redresse très silencieusement pour entrouvrir la fermeture éclair de ma tente. Des véhicules roulent au pas en contrebas dans la clairière, suivant le parcours sinueux d’une route que je n’avais pas vu entre les arbrisseaux. On m’a plusieurs fois conté des récits d'entraînements militaires, parfois à balles réelles ou utilisant des mortiers d’infanterie, prenant place dans des forêts publiques dans le secret. On m’a aussi conté des histoires de Floride et des États du Sud-est, réputés sans loi ni ordre, où l’on disparaît parfois sans laisser de traces après s’être aventuré dans les forêts locales. Les véhicules s’arrêtent. Les phares éclairent ma tente, mais de trop loin probablement pour que les conducteurs puissent en distinguer la forme sur le fond vert des arbres. Ce n’est probablement pas moi qu’on veuille éclairer, on s’est simplement arrêté ici, sur ce lacet de clairière. Mais pourquoi ? Je crains de rompre le silence de la nuit en respirant trop fort. Je reste ainsi à les observer une dizaine de minutes. Les portières claquent et résonnent dans la clairière et les véhicules continuent leur chemin. Je mets un peu de temps à m’endormir à nouveau.
16 mars
Je pars dans des lueurs grises qui précèdent l’aube. Les hauts pins détachent leurs formes noires contre le ciel. Je roule à nouveau (illégalement) sur la Florida Trail, éclairée de ma frontale. Le matin est frisquet, j’ai tout de même beaucoup dormi. La forêt est silencieuse. L’humidité matinale y lève une odeur de bois brûlé. La forêt a subi des "prescribed burns", des brûlis contrôlés afin de prévenir les incendies. Le sol noir de charbon exulte des fumées, et je vois parfois une lueur rougeoyante au creux d’un tronc noirci. Tous les sous-bois sont brûlés, mais souvent les grands arbres ne sont que roussis à leurs bases. À quelques endroits, la forêt entière a brûlé, et les arbres ne sont plus que des souches encharbonnées sur des centaines de mètres à la ronde.
La végétation s’appelle la « Florida Scrub », le petit pin, le Pinus Clausa, qui est endémique au sud des USA et dont les cônes ne s’ouvrent que dans les feux. Les grands pins qui me cachent le ciel sont des Pinus palustris, « longleaf pines », si bien nommés. Les feux ont détruit le chemin que je comptais emprunter. La forêt brûlée est terriblement silencieuse, et cela m'effraie tant que j’ai hâte de retrouver une grande route bitumée. L’odeur de bois brûlé semble porter du malheur avec elle. Je passe par des communes aux panneaux accueillant les « winter birds » (les Américains qui, comme des oiseaux migrateurs, passent leurs étés au nord du pays et leurs hivers au sud) qui s’alternent sur ma route avec des communes pauvres, dont les maisons sont des constructions simples de lattes de bois sur pilotis, sans isolation, ou des mobiles-homes mis sur parpaings. Les gens que je vois sur leurs porches sont souvent obèses. Je détourne les yeux par pudeur lorsque je croise des regards hagards, de corps et d’esprits usés et épuisés par la pauvreté et les mauvaises conditions de vie. À un carrefour, il y a une bicoque de tôle, et devant, des panneaux peints à la main sont enfoncés dans le sol mou : un homme a perdu sa maison dans un incendie et demande l'aumône. Je repense à la phrase du pilote de l’avant-veille. Je suis bien loin de Disneyland.
Les bords de route sont très sales, les sentiers des forêts nationales aussi. Je prends une voie verte jusqu’à Keystone Heights. Les bas-côtés sont larges et mousseux par endroits, et je m’aperçois que certains grands plats un peu en contrebas sont en fait des lits de vase, et la mousse un tapis de plantes aquatiques. La voie verte est construite sur un talus à travers des marécages. Des déchets flottent en surface.
J’arrive dans une petite ville. Sur une piste cyclable, un grincement affolé fuse de l’arrière de mon vélo. Je m’arrête brusquement pour l’inspecter. Mon disque de frein s’est désarrimé, il pend désordonné sur l’axe. Le moyeu est un système centerlock, et je n’ai aucun outil pour serrer convenablement le disque à nouveau. Je peste contre les monteurs du vélo, et le resserre comme je peux à la main. Je remonte à vélo et me hâte de bifurquer hors de ma route vers Gainesville, à une vingtaine de kilomètres, afin d’y trouver un magasin de vélo avant l’heure de fermeture (nous sommes un samedi). Je prends soin de ne pas freiner de l’arrière durant le trajet et je presse le pas, car il est déjà 17 heures. Je suis exténuée en arrivant, j’en ai trop fait de cette journée. Le mécano au magasin est très sympathique, et je lui demande, en plus de resserrer le disque arrière, de purger mon frein avant. Les freins hydrauliques SRAM de mon nouveau Warbird étaient sans poigne lorsque je l’avais réceptionné il y a un mois, et j’avais dû les faire purger à peine le vélo assemblé. À nouveau, le frein avant avait pris du mou depuis mon arrivée. Je suppose que les changements de pression durant le vol ont glissé des bulles dans le système hydraulique. Le soleil est proche d’être couché lorsque je sors du magasin. J’avais jeté des regards vers les bas-côtés, sur la route de Gainesville, et tous étaient marécageux. Je ne pourrais pas trouver un endroit où camper cette nuit, sans risquer de finir à l’eau. Je me demande s’il y a des petits crocodiles, si haut dans la Floride ? Je ne souhaite pas le découvrir.
Il y a un match de football américain ce soir en ville. Seul un motel miteux a encore une chambre de libre, à un prix exorbitant, probablement trois fois son tarif habituel. La chambre est sale, la porte ferme mal, la moquette est pleine de taches, les murs ont des trous mal rebouchés, et les joints dans la salle de bain sont moisis. J’inspecte les draps, je n’y vois pas de traces de punaises de lit et ils semblent propres. Je garde mes chaussures dans la chambre, car le sol me dégoûte, et j’essaie de ne pas toucher les surfaces. Toute la nuit, une famille qui se dispute dans la chambre voisine. Je ne peux m’endormir, car parfois ils crient, pour ensuite se taire, murmurer longuement, pleurer, geindre, pour crier à nouveau. Ils se menacent les uns les autres d’appeler la police. Je souhaite dans mon for intérieur qu’ils le fassent, qu’un grand final de vacarme et de cris les emporte loin de moi dans les lumières clignotantes rouges et bleues. J’essaie de me couvrir les oreilles des polochons repliés, en plus de mes boules Quiès, mais ce n’est pas assez. J'ai renforcé la porte d’entrée en poussant le lourd fauteuil râpé contre, et j’ai déplacé mon lit loin de la paroi de la chambre, afin de ne pas me trouver dans l’angle en cas de tir par balle mitoyen. Misérable journée, triste de ma faiblesse, de mon pathétique, de ma solitude et de mes loisirs de riche qui peut-être ne rendent pas si heureux. Et je sais aussi que je rechercherai à jamais le bonheur fou et innocent de l’aventure, que j’ai éprouvé sur la Transam, et cela, je suis convaincue que je ne le retrouverai jamais, pour tant de raisons. Et bien que je sois aux USA à nouveau, deux ans après mon premier voyage, le charme insensé de ce pays ne suffira sûrement pas à me faire éprouver à nouveau la beauté triste et sublime que je poursuis désormais vainement dans chacun de mes voyages. J’ai vu un tatou mort sur le côté de la route, ainsi que des sortes de grues et des dindons sauvages (ou peut-être était-ce les jours suivants).
17 mars
Je quitte rapidement l’affreux motel sale et poursuis au nord, afin de rattraper mon chemin quitté la veille. Il y a un fort vent de face, et je zigzague à l’envi sur des routes de terre et de bitume. Je souffre du vent, et le matin d'averses froides. La mauvaise nuit au motel a affecté mon moral : j’ai le pincement au cœur si spécifique de ceux qui veulent rentrer chez eux après s’être mis en tête qu’il leur fallait voyager. Je sais que ce sentiment passe, et je le garde comprimé derrière mon plexus jusqu’à ce qu’il s'étouffe comme les braises dans un seau à cendres.
Je m'arrête dans des petites villes. La population est très blanche, et obèse. Dans une station-service, la femme au comptoir m’appelle tour à tour, le temps de quelques phrases, « honey », « darling », « sweetheart », « hon’ », et même « baby », si bien que je ne peux que me dérider devant tant de mots doux. Les accents sont très prononcés, et j’ai plaisir à appeler tout le monde « sir » et « m’am ». Les petites villes sont parsemées d’églises baptistes et méthodistes, toutes de lattes blanches horizontales sur des petits remblais de gazon. Je vois des urubus à tête rouge manger des charognes sur les routes. Il y en aura beaucoup en Géorgie. Je vois des cardinaux : des sortes de verdiers (avec leurs gros becs), mais avec une huppe d’alouette, et surtout, un plumage pourpre comme un diable et un bandeau noir sur les yeux. Des trains de marchandise passent dans les plats en portant deux étages de conteneurs, si longs qu’ils mettent plusieurs minutes à passer. Je vois des ratons-laveurs filer furtivement dans les herbes claires. Les bords de routes sont toujours aussi marécageux que la veille. Parfois, lorsque je m’arrête, je ne distingue seulement lorsque je suis très proche de là où je m'apprête à mettre le pied, que le sol est en fait un couvert de vase, sur des eaux aussi noires que la terre elle-même. Je retrouve ma route, et ce détour à Gainesville peut désormais être classifié comme un mauvais souvenir.
Je passe par Lake Butler, puis l'Osceola National Forest. La « forêt », si verte sur ma carte, est en fait un immense marécage griffé de routes la traversant comme des caillebotis de terre. Les arbres y sont denses, avec leurs racines plongeant dans les eaux sombres. Le ciel est éteint derrière leurs ramures. Un des marais s’appelle le Big Gum Swamp. Tout est très sale, les routes sont fardées de canettes de bière par packs entiers, de paquets de chips et de cigarettes éventrés, de sacs entiers de détritus. Les canettes sont parfois rouillées, si vieilles qu’elles arborent d’anciennes versions des logos des marques, et je mets d’abord leur présence sur le compte des folies consuméristes et insouciantes du siècle passé, lorsque, me racontait ma mère, on jetait ses déchets par la fenêtre des voitures les jours chauds d’été. Or, souvent, les canettes sont encore brillantes et immaculées, comme si jetées la veille dans les entrailles du marais. Je suis dégoûtée. À une intersection, il y a une merde humaine plantée d’un drapeau, là comme on aurait posé un cairn surmonté d’une croix pour protéger les voyageurs. Je m’étais attendue, d’un marais sale, qu’il empeste la pourriture de vase et qu’il soit grouillant de moustiques, et ma consolation est que l’air y est clair, comme filtré par les eaux de toutes ses vilenies.
Je crains les aires de camping, car qui d’autre que des gens saouls et sales viendraient se terrer dans ce dépotoir ? Je vois à travers les arbres des lieux où des caravanes avec des pergolas, des barbecues, des quads, des réserves d’eau et des cordes à linge semblent être installées de manière quasi-permanente. Il n’y a pas de terre ferme entre les bayous pour y installer une tente, autrement que ces aires officielles (et ma crainte des crocodiles et des vipères d’eau est presque aussi grande que celle des hommes). Je pousse jusqu’à un « primitive campground », sans eau ni toilettes, avec seulement une poubelle blindée (contre les ours), sur un méandre de pelouses plates et de buissons, à peine surélevé au-dessus du niveau des marais. Dans un recoin de l’aire de camping, il y a une caravane, sans véhicule attenant. Je vais tourner autour, tentant de saisir par les objets laissés çà et là l’âme du propriétaire, et s’il est bon de dormir non loin de lui. Je dissimule ma tente à l’autre bout du labyrinthe de pelouses, cachée de taillis profonds. Autour de moi, les arbres sinistres enfoncés dans l’eau forment un mur, et les eaux des douves sont noirâtres. La nuit, les étoiles sont belles.
18 mars
Je quitte la forêt marécageuse et sale, dont j’aurais peut-être apprécié les routes sablonneuses si elles n’avaient pas été recouvertes de déchets. Je continue ma progression vers le nord péniblement, courbée sur mon cintre contre le vent. Je passe la frontière de Géorgie et j’atteins le village de Fargo sans eau. Il fait très beau, le soleil cingle mes joues salées. À la station-service, l’accent sudiste des clients est si fort que je peine parfois à comprendre des éléments de leurs conversations. Le vent venant du nord souffle plus fort encore que la veille, et plutôt que de continuer à lutter contre, je modifie mon itinéraire pour pousser vers l’ouest tout le jour. Rien ne se passe durant la journée. Il y a encore beaucoup de marais et de bords de routes inondés, mais les grandes forêts ont laissé davantage place à des friches ou à des forêts, si jeunes qu’elles ne cachent plus l’immense ciel bleu comme les grands pins de Floride le faisaient. Les bas-côtés sont larges de grandes tranchées remplies à demi d’eau, et je suppose qu’elles se remplissent tout à fait lorsque les pluies torrentielles balaient la péninsule. Je dors à Valdosta, dans un motel tenu par une dame très gentille. Les routes sont devenues, depuis que j’ai passé la frontière de la Géorgie, soudainement plus propres. Les maisons en lattes de bois légères sont mélangées avec de grandes et riches propriétés.
19 mars
Je suivrai toute la journée une route moyenne en direction de Cordele (nommée d'après la fille d’un colonel de la guerre de Sécession, Cordelia). Je vois beaucoup de vergers de pacaniers. Le vent de face est toujours fort, mais je fais avec. Je continue de naviguer entre des églises baptistes, parfois posées en bord de route loin des hameaux, des marécages clairs, et des vergers qui semblent peiner à se maintenir au-dessus de l’eau. La terre est rouge et striée de l’ocre des sables denses d’humidité. Je m’arrête à une station-service pour une Gatorade et une pause pipi. Je discute avec les clients, et on me demande où je me dirige ainsi à vélo. Un homme en uniforme militaire s’étonne lorsque je lui dis faire environ 150 kilomètres par jour. « I’m fit », je lui dis, et il me répond « You is ! ». J’aime cette grammaire paysanne, et son accent. Un autre homme me demande : « You carryin’ a gun ? – How could I, I ain’t American ! » Ils s’étonnent d’apprendre qu’on ne peut acheter une arme à feu avec un visa de tourisme. La Géorgie est un État de « open carry », où l’on peut porter librement et visiblement une arme de poing. Pourtant, peu le font, et je ne verrai finalement dans le Sud qu’un seul homme ainsi armé. Beaucoup ont des couteaux de chasse dans des fourreaux en cuir passés à droite dans leur ceinture. Le soir, je trouverai au Walmart une petite bombe au poivre, pour me protéger des nombreux chiens qui courent libres autour des fermes. Des lieux-dits portent le nom de « plantations », qui résonnent en moi comme les échos encore récents de l’esclavage. Je regardais Autant en emporte le vent dans l’avion. Je traverse des champs de coton, et les gros moutons blancs et fleuris s’envolent dans le vent et parsèment la terre sèche et le bitume. J’écoute Outkast pour couvrir le son du vent et me mettre dans l’ambiance géorgienne. Leur accent est celui des Noirs d’Atlanta, légèrement différent de celui que j’entends ici. Il me semble y trouver des traces de créole de français dans les sons et les expressions. « Money » se prononce presque « monnaie » (avec un « n » plus insistant qu’en français), des voyelles perdent leur diphtongue et se muent en un son long (comme on trouverait en néerlandais) : « say » est prononcé davantage « sééé » que « seille »…
En ville, j’arrive au moment où les bus scolaires jaunes font la sortie des classes. Je les suis dans les rues. Je passe par des quartiers noirs dans Cordele. Les adolescents me regardent d’un drôle d’air en sortant du bus. J’entends en passant deux d’entre eux qui parlent d’armes à feu sur le chemin. Au motel, je discute avec les patronnes. Elles sont exaltées de fantasmes de France et d’Europe et étonnées de me voir là. Je prends goût à dormir dans des motels, et la tentation est aussi grande que l’insécurité réputée du Sud-Est devient prétexte.
20 mars
Le matin est froid. Je pars dans un vent violent, allant contre moi, et qui durera toute la journée. Je passe dans de grands vergers de pacaniers, interrompus par les églises de lattes blanches et des petits hameaux. Je change plusieurs fois ma route, essayant de poursuivre au nord-ouest en godille, afin de ne pas prendre le vent tout à fait de face, mais de l’alterner de côtés en poussant tour à tour au nord, puis à l’ouest. Je me résous finalement à affronter le funeste élément. J’entre dans les collines. Après Montezuma, je quitte complètement les marécages et les hameaux sordides de pauvreté qui me faisaient détourner le regard avec pudeur. Les drapeaux confédérés se multiplient. Beaucoup souhaitent taire cet héritage afin de le supprimer, et en retour d’autres s’en enorgueillissent de surcroît (sentant leur suprématie menacée). En Géorgie, au 19e siècle, 5 à 10 % de la population possédait 50 % de la population. J’entre dans des collines de pins, entrecoupées de zones de petits plans dégagés, déjà pris par des jeunes fougères qui y croissent vite avec la fin de l’hiver. Quelques fermes font pousser du blé, avec au pacage quelques têtes de bétail et des chevaux. Je vois des chèvres. À Talbotton, les visages funèbres des habitants me font renoncer à m’arrêter prendre de l’eau au magasin général. Je poursuis ma route dans la ville désolée. Les rues sont ombrées de déchets poussés dans les caniveaux par le vent. Des journaux sont collés dans les buissons. Des monticules de feuilles mortes sont entassés dans les recoins des bâtiments municipaux, mêlés de papiers. En sortant de la petite ville, je croise trois bâtiments à moitié détruits. L’un est coupé de sa moitié et sa toiture tombe sur les gravats. Un autre a un de ses angles fauchés, et on voit l’intérieur des pièces en désordre. En passant entre eux, je comprends : l’alignement des destructions forme un couloir, comme dans ces cartoons où un personnage continue sa route tout droit, en imprimant sa silhouette en trous successifs dans les bâtiments. Une tornade est passée à travers la ville deux semaines auparavant. Les bâtiments de briques ont seulement perdu des tuiles, mais les maisons de bois ont été terrassées. Voilà pourquoi les habitants de Talbotton avaient l’air si malheureux. Devrais-je arrêter mon voyage et rester afin d’aider à dégager les gravats et reconstruire des vies ? Subitement, j’en ai des visions : je me vois logeant dans le centre communautaire, humblement, la nuit dans mon sac de couchage, et le jour, j’aurais des gants de cuir et j’aiderais à guider les machines. Je déblaierais à la main les gravats et retrouverais des jouets d’enfants que je rendrais à leurs propriétaires. Je serrerai la main à mes nouveaux compagnons de travail et on me prendrait dans les bras, « grateful ». Un piano jouera des airs charmants de blues. Je n’ai aucune connaissance des travaux publics, mon dos ne supporte pas les charges, je suis un fardeau à loger et nourrir. Je ne sers à rien. Je continue ma route.
Les cardinaux sont nombreux dans les forêts, comme dans les champs. Je contourne les routes de bitume par l’autre côté des collines, sur des routes de terre et de gravier. Parfois, les routes de ma carte n’existent plus et les détours me font tirer bien loin avant de revenir. Je me sens une poussée de force et d’excitation qui semble infatigable. Cela faisait longtemps que je n’avais plus ressenti cette plaisante fatigue, depuis que j’avais arrêté la course à pied et que je prenais trop d'amphétamines. Je me plaisais tant à devenir de marbre, une machine à vapeur de distances fixes, sachant fermer son esprit et ses émotions, et qui avait écrasé les seuls rivaux qui ne m'avaient jamais importé. J’arrive à Warm Spring, un village thermal au milieu des collines. F. D. Roosevelt paraplégique y finit sa vie et un monument lui y est dédié. La ville est calme, avec une douceur nostalgique dans la fraîcheur du soir. Demain, c’est l'équinoxe de printemps, et même si les teintes claires des feuillages ne sont pas encore revenues, un arbre aux pétales roses, déjà, fleurit, et on voit ses bourgeons colorer les collines.
21 mars
Aujourd’hui, le vent souffle entre 25 et 30 km/h de face, en plus de gronder de bourrasques. La journée est très dure. Les villes m’apparaissent néanmoins de plus en plus sympathiques. Les bâtiments sont faits pour la plupart de briques à présent, et les gens ont le visage ouvert. Dès Hogansville, je suis déjà bien rossée par le vent. Je fais alors un joli détour par le sud de Franklin sur des routes de gravier. Je ne suis plus loin de la frontière de l’Alabama, maintenant. J’avais pour intention de monter plus au nord, afin de toucher aux Appalachians au-dessus d’Atlanta, mais un retour de froid du nord y fait chuter les températures, et je ne suis pas équipée pour des nuits enneigées. Au sortir du supermarché, une très vieille dame tombe du trottoir devant moi en rejoignant sa voiture. Elle est légèrement blessée et des EMS sont appelés. Je pose mes achats à terre pour aller auprès d’elle et je vais chercher ses clefs que j’ai vu plonger sous un véhicule lors de sa chute. Nous sommes déjà plusieurs à l’aider et je reste de côté, les clefs à la main. Sa fille, d’une cinquantaine d’années, vient me demander si j’ai vu l’accident et me pose quelques questions. Je dois lui faire répéter plusieurs fois des phrases tant son accent est fort. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant, ni depuis. Il me semble en reconnaître les inflexions des Appalachians dans sa voix (et elle diffère beaucoup des gens alentour).
Le vent a encore forci et je renonce à entrer dans les forêts d’Alabama aujourd’hui pour me rabattre sur Bremen. La nostalgie et l'inquiétude du voyage m’ont quittées, mais j’éprouve tout de même le besoin d’envoyer des messages et de converser avec des gens de chez moi. Je me suis adoucie, me semble-t-il, en à peine quelques années. Le feu des débuts où il me semblait n’avoir besoin de rien, pas de réassurance, pas d’humains, pas de mots, seules des forêts, semble s'étouffer. Chaque année, je semble me renouveler, repenser ma passion, en la comparant sans cesse aux souvenirs que je me fais de mon moi ancien, comme si je l’avais quitté, comme s’il n’était plus moi, alors que mon existence est la multiplication de ces versions de moi-même. J’ai ressenti aujourd’hui le débridage du voyage, où les kilomètres semblent plus faciles, la fatigue mentale disparue le soir, et les blessures guérissent tout à fait durant la nuit. Les mots de Dylan en Alaska me resteront toujours en tête, cette affirmation qu’il dit dans le courant de la conversation (peut-être pour l’oublier après, tandis qu’en moi, elle se gravait à jamais comme une vérité absolue) : cela prend cinq jours pour se mettre en jambes lors d’un voyage à vélo. Il avait un an de moins que ce que j’ai à présent. J’avais dit cette phrase à A lorsqu’il traînait la patte en peinant à traverser le Jura, il y a déjà deux ans, et il m’avait demandé qui était Dylan. J’avais cru voir un genre d’alerte, une fermeture vive et rapide dans son visage, ce qui m’avait étonné, car jamais je n’avais vu cela avant dans le visage de quelqu’un. Depuis, j’ai bien souvent recroisé cette alerte, mais uniquement dans mon propre visage. Je l’ai aussi ressentie dans le point le plus profond de mon estomac (à remonter en boule dans la gorge), et je sais maintenant que l’hypothèse que j’avais formulée lorsque j’avais vu cette expression sur le visage d’A était la bonne : c’était de la jalousie. Le camping est populeux, de caravanes et de bruits, de grands feux qui chassent leurs fumées vers les tentes, et je me dirige vers un motel, en pestant contre mon manque de volonté, car dormir dans des bâtiments m’apparaît comme une faiblesse, une entaille à mon honneur de cyclotouriste. J’aime les collines de longleaf pines.
22 mars
Je pars un peu tard, car le matin est froid. Mes doigts gèlent au bout de mes gants. La Géorgie a une terre d’argile d’un rouge profond comme celui des entrailles. Le vent de face continue, mais, arrivée à la frontière de l’Alabama, il cessera car je bifurquerai pour suivre la ligne des montagnes (la queue des Appalachians, d’une nature géologique différente) vers le Sud-ouest. Les collines sont à présent couvertes de pâturages et de granges peintes en rouge. Je retrouve l'itinéraire que j’avais quitté. Je prends la Silver Comet Trail, une piste cyclable qui traverse la forêt. Un portique au milieu de la piste délimite la frontière d’État. Je le traverse en écoutant « Sweet Home Alabama » et je m’y arrête juste après pour m’y prendre en photo. Je trace vite sur la grande voie de train reconvertie. Je passe à travers de larges blocs de granit où l’on voit les cicatrices des barres à mine. J’atteins Piedmont où je me ravitaille. Je pense à Jean Giono et Angelo Pardi. La ville est bien nommée, elle est dans un bassin plat d’où on voit la chaîne de montagnes, d’un vert mauve d’arbres d’hiver, et ce n’est que lorsqu’on s’approche qu’on distingue les bourgeons du printemps. Je parcours l'Alabama Skyway, une route de bitume qui traverse la chaîne en serpentant sur la crête, passant tantôt à gauche, tantôt à droite des cimes de la Talladega National Forest. J’aime ce paysage. Les collines ont des pentes abruptes, les sommets et les flancs sont couverts de hauts pins longleaf et les creux des vallées de chênes et de feuillus. Des blocs de pierre dépassent de la terre marron comme poussées des dents de roche. L'espacement des pins et la hauteur de la canopée permettent de voir au loin la chaîne de collines qui s’étale vers la plaine. Le nord de la forêt a des zones de brûlis préventifs, que je traverse encore fumants et inquiétants. Quelle belle et chaude journée au milieu des pins ! J’alterne le bitume avec des routes de gravier. Je m'arrête tôt à un camping national qui s’étale dans un creux de terre battue près d’une petite rivière. Je vais filtrer de l’eau et me baigner les pieds dans le cours d’eau. Le soir, je discute avec une femme d’Alabama qui me montre des photos du coin sur son GSM. Sa ville a été traversée par une tornade, et elle me montre la photo d’une porte en alvéolaire traversée de part en part d’un shrapnel de bois de la taille d’un avant-bras, et d’une toiture défoncée par des débris giflés par le vent. Sa grand-mère était medicine woman au Kentucky. Son fils joue aux jeux vidéo, à son grand désespoir, car elle n’aspire qu’à s’échapper en forêt avec son van et son border collie. Elle laissa le fils à la maison pour venir ici ce soir avec le chien. Je lui dis aller en Californie. Elle n’est jamais allée à l’Ouest. L’idée que je le fasse à vélo ravive en elle le désir de pousser jusqu’à la côte en van. Je lui souhaite de le faire.
23 mars
Je me réveille durant la nuit, car le froid me prend les pieds et les chevilles, mais je me rendors plutôt facilement. La forêt est ici encaissée près de la rivière, les températures doivent plonger avec l’humidité. Au matin, la condensation a complètement mouillé ma tente. Mes doigts gèlent en route vers Heflin, à 15 kilomètres de là, mais se réchauffent aisément lorsque le grand soleil vient les frapper dans les trouées. La petite ville est jolie, vide dans le samedi matin. La population est plus blanche que dans le sud de la Géorgie. Je remonte dans les montagnes par des petites routes, et je passe une belle après-midi à suivre la crête de la chaîne, par Cheaha Mountain (726 m), le point le plus haut de l’État. Il y a beaucoup de monde ce samedi, et je ne m’y attarde pas autant que je l’aurais voulu. Je perds mes tongs que j’avais accrochées au sandow de ma sacoche de selle. Je les avais achetées à Washington en 2016 pour sécher mes pieds de tranchée, et j’avais passé l’été avec. En les emportant, je savais que je les perdrais. Je continue l'Alabama Skyway, qui se termine pour devenir du gravier assez accidenté de morceaux de pierres rondes. J’entends la ligne du train hurler d’en bas, et je vois quelques 4 x 4. Les pins ont laissé place à une végétation mixte, avec des buissons touffus et des chênes dont les glands sont particulièrement gros. Des petits lézards verts gonflent leurs gorges sur les arbres et il me semble qu’ils changent de couleur lorsqu’ils sont sur de la végétation marron. Il y a des gros rochers sans mousse. Les bourgeons sur les arbres me semblent plus ouverts que la veille. La terre rouge apparaît encore à des endroits, comme des écorchures dans le marron épais de la terre. Des hauteurs, je vois parfois des cultures en contrebas, vert clair entre les arbres sombres. Je m'arrête encore dans les limites de la National Forest, à 15 kilomètres de Sylacauga, au fond d’un chemin barré aux véhicules par des arbres tombés. Je place ma tente au bout d’un promontoire rocheux d'où j'aperçois la vallée entre les futaies. Mon pneu semble avoir perdu de la pression. La nuit, j’entends des animaux proches de moi, dont je ne sais pas identifier les sons. J’ai plus chaud que la veille.
24 mars
Je ne pars pas aux premières lueurs, comme je l’avais souhaité, car, à mon réveil, mon pneu arrière est à plat. Je change la chambre, pose une rustine et je descends en ville. Il fait chaud très tôt dans la journée. J’ai enfin un vague vent de dos et je trace les 190 kilomètres de collines jusqu’à Tuscaloosa. Je sens enfin mes fesses rodées à la selle et mes jambes ont regagné de leur endurance. Je ne m’arrête que 20 minutes à midi pour dévorer des pop tarts (celles sans le « frosting » de sucre), puis encore une fois à 15 heures, lorsque je ressens un puissant coup de fatigue. Je bois beaucoup de Gatorade et d’eau. Je lave les cristaux de sel qui forment de la poudre sur mon visage. Dans une accalmie de plaine, à une station-service déserte, je goûte à un de mes plus grands plaisirs depuis quelques années : prendre un grand café bouillant avec un paquet de bonbons. Le café chaud fait fondre en bouche les bonbons qui coulent de sucre sur l’arrière de la langue. Le sucre et la caféine me ravivent. Je ressens l’ivresse de la fatigue des longues journées, qui demeurent associées dans ma mémoire à lorsque je suis rentrée à Washington DC d’Indianapolis en 2016. J’avais poussé tous les jours brûlants et sous les pluies des Appalachians, ne m’arrêtant seulement aux stations-services pour manger debout comme un cheval (et de prendre des cafés avec des bonbons) avant de repartir. Je me sentais dans mon élément, après un mois de long voyage, furieuse comme un enfant sauvage d’un amour dont je ne devinais pas le nom. Le rock de la station-service est bien la musique que je pensais entendre en Alabama. Ma peur d’échouer, vaincue d’épuisement, avant Tuscaloosa est aussi forte que mon excitation, et dans mon empressement, j’arrive finalement assez tôt à Tuscaloosa. Je me sens fumée, mes muscles tendus sous la peau chaude, mon corps bougeant lentement au rythme de larges et lentes respirations. Un orage fort s’annonce tournoyer sur toute la zone, jetant des pluies et des vents terribles une bonne partie du lendemain.
Voilà neuf jours déjà que je suis partie. Je m’accorde une pause d’une journée le lendemain. Tuscaloosa est connue pour un événement historique : en 1963, on tenta d'empêcher les deux premiers élèves noirs d’entrer à l’université. Je reconnais les photos de ces deux personnes traversant la foule, protégées par les policiers, sous des regards de mépris et de haine. La photo est silencieuse, et j’en imagine une colère froide et des grimaces hautaines de dégoût, mais probablement y avait-il des cris, des insultes et des objets jetés. Je n’avais jusqu’à peu pas compris cette scène de Forrest Gump, où Tom Hanks s’y trouve incrusté et qu’on lui dit « Coons are tryin’ to get into school ».
J’ai à nouveau croisé sur la route des arbres réduits en aiguillettes, leurs troncs scindés en immenses échardes par les coups brutaux des tornades.
25 mars
Jour de repos. Je n’irai même pas en ville. J’aurais sûrement dû, par curiosité, aller voir le campus de l’université. Le matin, je discute avec le manager du motel. Il me raconte son histoire, sans que je ne lui demande rien. Voilà son histoire, telle qu’il me l’a racontée : il était dans sa jeunesse un voyou, sa petite amie était « wicked » (dans sa prononciation, je ne comprends pas tout de suite s’il me dit bien « wicked » ou « wicca »), elle lui faisait vénérer des bougies et faire des incantations (je pense là qu’elle faisait de la sorcellerie d’adolescente, avec des pentagrammes, des bougies et des talismans de chez Claire’s). Il renia la religion de son enfance, détestait son dieu pour lui avoir donné une vie si misérable et adorait presque le diable. Il vécut du crime, méconnaissant l’avenir. Puis, par deux fois, Jésus Christ lui apparut en vision. La seconde fois, ce fut en un rêve hallucinatoire sur un lit d'hôpital, après s’être fait tirer trois fois dessus lors d’un vol de rue. Il vit par delà les murs et le plafond le ciel qui s’ouvrait, et le Christ se manifesta. Il lui dit qu’il l’aimait, peu importe ses torts, qu’il le pardonnait et l'aimerait toujours, inconditionnellement (et je crois que ses yeux se mouillent de larmes à l’évocation de cette rencontre). Après cet épisode, il se reconvertit à sa religion, en répandit la bonne nouvelle, retourna dans un chemin droit. Il reprit ses études et devint manager de ce motel. Il me dit avec fierté qu’il est le mieux noté de toute la ville. Dans le réfectoire, il y a au mur des tableaux avec des citations bibliques. Il me parle du gospel et de ses bienfaits. J’écoute son histoire, impressionnée, incrédule. Je regarde les tatouages qui dépassent de son cou, avec le nom du gang de son quartier et le nom de son frère décédé d’une overdose sur le bras. Il me demande comment je suis « devenue » athée, confondant en une même notion l’absence de foi avec le rejet de Dieu, présupposant ainsi l’état naturel de l’humain comme croyant. Plusieurs fois dans mes voyages, des Américains m’ont soutenu leur foi, qui les sauva et les garda d’eux-mêmes, convaincus fervemment qu’un père veille sur eux, et qu’ils ne sont plus des enfants seuls et effrayés. Et presque chaque fois, ces élans prosélytes sont inspirés, et les visages portent des expressions de gratitude. La joie et la paix qu’ils souhaitent partager sont sincères, comme si elles étaient si fortes qu’ils ne pouvaient les contenir, qu’ils en débordaient tout autour d’eux.
Depuis dix jours, j’essaie de me souvenir des panneaux que je rencontre devant les églises et qui annoncent l’amour du Christ. Ce sont les mêmes panneaux que devant les motels ou les restaurants : des carrés blancs où l’on insère des grandes lettres capitales sur des lignes, pour en changer le message toutes les semaines ou tous les mois. Le seul dont je me souvienne n’est pas le meilleur : « Life without Jesus is like an unsharpened pencil : it has no point. »
26 mars
Je repars de Tuscaloosa pleine d’énergie. Je traverse la ville en passant par le campus universitaire. Il ressemble à ces images de sitcoms, avec des pelouses de gazon frais et bien coupé, parcourues de chemins gris qui relient les nombreux bâtiments. Les maisons de fraternité et de sororités sont alignées, et il y a tendu sur des poteaux des bannières de l’équipe de football américain locale (« Roll Tide! »).
Je passe par des routes de terre dans les collines. Il fait beau et chaud. Des chiens me poursuivent lorsque je passe près des grillages et des palissades hautes qui dissimulent des maisons. Lorsqu’ils se mettent en chasse, je crie, plus fort qu’ils n’aboient : « Stop ! », et bien souvent ils arrêtent leur course au premier ordre. À un moment, c’est une meute d’une douzaine de bâtards de toutes les tailles et de toutes les formes qui me poursuit en jappant, et j’arrive à les semer en poussant fort.
J’avais craint le vent, mais il n’est pas aussi dur que ce que j’avais pensé. Je m’arrête à Carrollton à midi et quitte les routes de terre pour des routes bitumées plus larges. La paroisse locale a eu le cinquième plus haut taux de lynchage de tout l’Alabama. Des gens prennent en photo le monument de la grand’place. J’entre au Mississippi par le pont de Pickensville, au-dessus de la Tombigbee River. Le paysage s’est aplati, les longues pinèdes plates sont mêlées de feuillus. Je m’arrête peu durant la journée. Je trace entre les forêts plantées sur la terre rouge et les pâturages aux nombreux chevaux et vaches. Lorsque j’atteins le Mississippi, il y a de très grands champs, s’étendant à perte de vue, mais les labours sont mystérieux en mars, et je ne sais si ce sont des céréales ou du coton. Je vais droit vers l’Ouest.
À Brooksville, au magasin général, un très vieil homme en voiturette électrique se gare près de moi tandis que je range mes affaires sur mon vélo et me demande de sa portière si je peux aller lui acheter une boîte de raisins secs, en m’appelant « jeune homme ». Je retourne dans le magasin, fais le tour des allées serrées, puis finalement demande à la caissière la « box of raisins ». Elle ne me comprend pas tout de suite et, en le prononçant pour la seconde fois, je me rends compte que ma bouche ne sait décider si le « s » doit tendre vers un « ss » ou un « z », malgré avoir entendu ce même mot prononcé quelques minutes auparavant. Je le prononce d’abord « race-inn », puis corrige en « raise-inn », et la caissière alors comprend, rit et me dit adorer mon accent. Je suis un peu confuse d’avoir été si facilement découverte. Ses dents sont décorées de grills.
Vers 17 h je sens la fatigue m’atteindre. Je suis sur une des longues routes désertes qui tracent au cordeau dans les pinèdes du Noxubee Wildlife Refuge. Je m’arrête et goûte assise sur une barrière de bois qui bloque l’entrée des sous-bois aux véhicules, puis pousse doucement jusqu’à la forêt de Tombigbee. Je serpente dans de petits vaux de routes de terre orangée et étroites, avant de dormir sur un petit mont dégagé, dans un grand silence. Quelle région charmante ! Des collines roulantes sont couvertes de forêts et me rappellent mes sorties dans la Beauce ou le Perche. Les hameaux sont calmes, et devant les maisons proprettes, des gens tondent le gazon en saluant chaleureusement de la main. La lumière est belle et rend l’endroit apaisant avec les ombres qui s’allongent, et même les mares inquiétantes d’eau sombre en sont un peu moins terrifiantes. Je vois des dindons le soir. Lors de ma pause de l’après-midi, sur la barrière de forêt, j’avais lu le panneau informationnel à l’usage des chasseurs, sur lequel étaient indiquées les ouvertures et les fermetures des chasses, et les gibiers de la région. La chasse aux dindons est ouverte, et je n’ai croisé aucun chasseur. Le soleil se couche quelque temps après 19 h.
27 mars
La nuit a été froide, je me suis réveillée de frissons plusieurs fois durant la nuit. La rosée a trempé complètement ma tente, et la paroi extérieure colle sur toute sa surface à la paroi intérieure. Il y a une fine pellicule de gel sur ma selle qui se décolle et fond lorsque je la pousse du bout de l’ongle. Mon pneu arrière est à plat. Je dois changer la chambre alors que le froid et l’humidité engourdissent mes mains, et elles me font très mal lorsque j’appuie avec pour faire sauter le pneu et le replacer. Je repars un peu plus tard, et je joue sur le réseau de sentiers roulants. Je m’arrête à un lac. Il est dans un très large creux, et mes pas sur le bitume résonnent dans la forêt lorsque je marche jusqu’à son bord.
Je continue ma matinée sur des routes de terre, dans des forêts entretenues avec peu de hameaux. Je fais sécher ma tente en déjeunant à Eupora. Pour la troisième fois depuis le début de mon voyage, on me demande si je porte une arme à feu pour me protéger. L’après-midi est très chaude. L’accent des habitants n’est définitivement plus le même qu’au Sud-est, et me rappelle davantage l’accent chantant que j’avais entendu au Kansas, avec, comme l’accent texan, une voix plus basse et monocorde chez les hommes, et une prononciation presque ventriloque. Dans un village, un homme vient me parler et me quittera après m’avoir mise en garde, lorsque j’arriverai en Californie, contre les « homeless who defecate in the woods » (il ajouta, avec un air préoccupé : « you know what « defecate » means, right ? ») Voilà la plus étrange recommandation que l’on m’ait jamais faite.
Les routes rouges sont belles, mais j’ai beaucoup pris le soleil. Ma peau me brûle un peu, et je me sens assommée des rayons contre mon front et mon crâne au travers de mon casque. Je coupe court à ma journée et m’arrête à Grenada, plutôt que de pousser jusqu’à Enid Lake comme je l’avais prévu. Je ne me sens pas très bien. Ma route m’emmène à travers un camp d’entraînement de la National Guard en passant entre les baraquements. Des jeunes soldats en uniforme marchent en groupe d’un pas décidé. J’ai un doute sur la légalité de ma présence. Je n’ai pourtant pas vu de panneau m’interdisant l’entrée. Je demande à un officier arrêté devant un bâtiment si la route est bien publique, et il me répond en souriant.
Dans Grenada, je passe par un quartier où les trottoirs sont soulevés par les racines, et des herbes folles poussent dans les interstices. Les maisons sont très grandes, sur plusieurs étages, d’architecture coloniale américaine avec des balustrades de bois ornementées. Beaucoup sont délabrées, et la peinture blanche des façades de lattes s’écaille et des mousses poussent sur les tuiles et les gouttières. Dans les jardins, l’herbe est haute, et parfois des carcasses de voiture y sont abandonnées. Il m’est toujours dur de distinguer les quartiers pauvres ou malfamés, aux États-Unis, car il m’est encore difficile de concevoir que l’on puisse vivre en dessous du seuil de pauvreté tout en ayant plusieurs chambres dans une grande maison. Je croise des hommes noirs qui discutent en buvant des bières, assis sur un porche. Ils s’interrompent un instant pour me regarder silencieusement passer. Je risque un regard vers eux, mes yeux dissimulés derrière mes lunettes de soleil. Il me semble lire de l’étonnement, mais aussi de la méfiance (ou du dégoût ?) dans cette vision furtive. Jeune fille blanche à vélo, je détonne dans le paysage. Je n’ose pas les saluer. Est-ce là un avant-goût du Delta du Mississippi, dont la pauvreté historique est connue dans tout le pays ?
28 mars
Je pars peu après le lever du soleil et rejoins le tracé de la Transamerican Trail, une route de motocross qui traverse les États-Unis d’est en ouest. Je suis à nouveau dans des collines. Dans beaucoup de hameaux, des maisons sont affaissées, comme tombées de côté un jour où l’on n’y prêtait pas attention. Il y a beaucoup de mobil-homes posés sur des vastes terrains vagues. Des chiens se mettront à ma poursuite toute la journée, seuls ou en groupe. J’en perds le compte après la trentaine. Parfois, ils tentent de me bloquer la route, et j’ai ma bombe de protection en main lorsque je leur somme de dégager d’un cri autoritaire. Je passe par Tallahatchee County, celui de « Ode to Billie Joe ». Je croise un élevage de bœufs qui pataugent dans de la boue puante qu’ils ont jusqu’en haut du boulet. Leur enclos est très petit, ils sont serrés. Juste à côté, il y a un cimetière. Des urubus volent au-dessus. J’entends dans la journée de mélodieux chants d’oiseaux.
Les collines s’arrêtent abruptement et j’atteins la plaine du Delta. Le vent vient du Sud, ce qui m’aide au commencement, lorsque je monte un peu au nord, mais devient dur à supporter lorsque je bifurque tout à fait vers l’Ouest à nouveau. Le Delta est couvert de champs de coton. Parfois, je sens dans l’air une odeur de putois. Il y a quelques hameaux qui semblent tristes et désolés, et un strip-club abandonné. Je ne croise pas de magasin de la journée. Je m’arrête à l’ombre d’une église pour reprendre de l’eau potable au robinet et laver mon visage plein de sel. J’écoute de la musique pour couvrir le bruit du vent, du blues qui fait résonner le sifflement du vent dans les champs de coton qui m’entourent. Un serpent noir sort d’une craquelure du bitume chaud, presque irréel.
Le Mississippi est en crue. Il y a eu un vortex polaire en début d’année sur le continent, et les fortes chutes de neige sont responsables maintenant de montées d’eau dans tout le pays. Les plaines sont inondées, et je regarde les arbres qui dépassent des flots pour tenter d’estimer la hauteur du lit lorsque je traverse le fleuve. Me voilà en Arkansas. Helena – West Helena a mauvaise réputation, comme beaucoup de villes d’Arkansas. Je contourne la ville en hâte pour aller camper à la Delta Trail. J’arrive à la fermeture du camping du départ de randonnée, et discute avec la patronne qui réouvre son comptoir pour moi. Elle est très sympathique. J’entends la circulation de la large route qui passe près de là durant la nuit. D’horribles araignées me surprennent près des bâtiments.
29 mars
J’ai eu du mal à dormir. Je prends un café à la station-service, et j’écoute l’accent des routiers. Je continue le tracé de la Trans American Trail. Je croise un arrêt aménagé par des bénévoles pour les voyageurs : dans une guérite décorée se trouve de l’eau, des bancs et des chaises pour se reposer à l'intérieur ou sous le porche couvert, et un livre d’or. Il y a une fausse prison. La guérite est couverte de stickers de motards, dont un porte « Welcome to Redneckistan, AR. » Une femme me salue.
Plus loin, je me fais attaquer par deux chiens. Des sortes de bâtards de Rottweilers gardent un mobil-home décati, posé sur un terrain vague au milieu de rien, et se mettent en chasse dès qu’ils me repèrent sur la route de terre en contrebas. Ils me rattrapent vite et je ne parviens pas à les semer. Lorsqu’ils atteignent mes mollets et tentent d’y faire claquer leurs mâchoires, je les touche aux yeux avec le jet de ma bombe au poivre que j’avais dégainée à leur approche. Ils arrêtent instantanément leur course. Ils n’ont pas l’air d’avoir mal, mais semblent juste déconfits. Je ris de ma victoire : voilà ma vengeance sur les dizaines de corniauds qui me poursuivirent aux confins de la Roumanie. J’ai un terrible sentiment de puissance et d’invincibilité face à cette ancienne crainte, qui réveille une inhabituelle cruauté. Je souhaite maintenant infliger le même sort à tous les chiens méchants de la terre, et je le ferai avec un plaisir sadique. Un fort vent de face se lève et durera tout le reste de la journée. Je crève à nouveau sur un bord de route. La White River est en crue, et lorsque je la traverse, des centaines de milliers de gros moucherons sales me frappent au visage et au corps, comme des rideaux de petits plombs, au point d'endolorir mon épiderme. Cela dure plusieurs heures, tout aussi longtemps que je resterais dans les bayous qui prolongent la rivière et les terres humides des crues. Je respire par le nez, la bouche pincée pour ne pas les laisser rentrer. J’en ai plein le t-shirt, des dizaines de cadavres sont collés par la sueur entre mes seins et ma brassière. Je trouve enfin un répit du vent et des insectes lorsque je longe le fleuve Arkansas (lui aussi en crue). Il pue d’une invraisemblable odeur d’Apericube. Les plaines alentour sont aussi inondées, et les pieds des arbres de la ripisylve (des genres de peupliers ?) sont élargis et répandent leurs racines, comme pour flotter, comme habitués à être à demi-immergés. Les poteaux électriques qui bordent les routes ont les pieds dans l’eau, même les larges tours de câbles.
J’arrive à Pine Bluff, ville à la réputation terrible. Peu de ponts traversent le fleuve Arkansas et, lorsque j’étudiais ma route, j’avais vu que je n’avais que peu d’options : il me fallait choisir entre passer par Pine Bluff ou Little Rock, capitale de l’Arkansas. Les deux villes ont parmi les plus hauts taux de criminalité par habitant du pays (5 fois la moyenne nationale), des problèmes de drogues dures et un taux d’homicide 10 fois supérieur à la moyenne des États-Unis. Je dors dans un motel en périphérie et traverse la ville dans la matinée. Je croiserai des commerces fermés, des maisons aux fenêtres placardées de bois. Les parcs à l’abandon sont ornés de graffitis de gang (crips et 69), marquant leur propriété effective et leur suprématie sur ce champ de bataille désolé.
30 mars
À nouveau, un vent de face domine toute la journée, soufflant à 20 ou 25 km/h, d’une constance lassante. Dès mon départ du motel, j’ai mes écouteurs, n’ayant pour but qu’atteindre Hot Springs le soir avant la fermeture du magasin de vélo. Je prends à midi mon premier repas chaud de mon voyage : une pizza dans une station-service. Il y a une petite bruine lorsque j’atteins la ville. Du magasin, je la vois qui se mue en averse, poussée par le vent, et je m’installe. Je me sens hors du temps dans ce magasin, à discuter doucement et à regarder la pluie strier le macadam de la fenêtre. Je discute avec les deux tenancières qui ont une soixantaine d’années. La nièce d’une d’entre elles passe dans le magasin pour demander un entonnoir pour remettre de l’huile dans son pick-up. Le rythme de la station-service est lent. Une grande partie du magasin est large et vide, avec des tables où l’on pourrait rester à voir défiler les heures en regardant tomber la pluie derrière les baies vitrées, et discuter avec les gens de passage, qui tous prennent le temps d’échanger sur leur journée ou sur le temps. Je repars dans les derniers moments de l’averse, je sens l’éclaircie venir. Je sens dans mes jambes que les collines deviennent plus nombreuses, plus abruptes, que les replis telluriques sont plus denses et plus profonds au fur et à mesure que j’avance en Arkansas. Cependant, je ne le vois pas dans le paysage, tant le vent me plie en deux sur mon cintre, les mains en position basse, à regarder seulement ma roue avant. À une intersection, je pose mon vélo, ôte mon casque et mes écouteurs, et je serre tous les muscles de mon corps, les coudes rentrés dans le creux des hanches, les genoux serrés et fléchis, les épaules arquées et les biceps tremblant d’être bandés, et je pousse un cri long et fort venant du profond de ma poitrine, qui résonne dans les arbres. Je me redresse, soulagée, et je reprends la route. Je dois à un moment m’arrêter à nouveau pour prendre de la ventoline. Le vent de face se force dans mes poumons à chaque inspiration et les violente. J’en hyperventile, et parfois il me semble que mes poumons ne tirent rien lorsque je les gonfle, comme s’ils étaient crispés du choc qu’ils recevaient à chaque insufflation. La Ventoline aide à les détendre, il me semble.
Hot Springs est une ville encaissée dans un croisement de vallées grises dans les montagnes Ouachita, et organisée sur un plan qui suit la longueur d’une longue rue. Le magasin de vélos est surtout pourvu de gravels. Je reste jusqu’à la fermeture à discuter avec le couple qui le tient. Je leur demande leur avis sur mes freins, qui ont, à nouveau depuis Gainesville, repris un peu de mou. Les freins hydrauliques Sram ont mauvaise réputation. La scène gravel est en formation à Hot Spring. L’Arkansas devient un profond bastion de ce type de cyclisme, qui a commencé dans les Ozarks et se répand vite. La femme est enceinte de 8 mois et me dit qu’elle appellera son fils « Ryder ». Garderai-je, moi, une passion aussi longtemps dans mon cœur pour en nommer des enfants ? À chaque âge de ma vie, les enfants que je n’ai pas eus et que je n’aurai jamais auraient porté des noms étranges qu’ils ne m’auraient jamais pardonnés.
Hot Springs connut une apogée en tant que ville d’eau dans les années 20, l’architecture de la ville en est marquée. Je me promène dans les rues et admire les bâtiments. Des passants remplissent leurs bouteilles à des fontaines qui distribuent de l’eau de source. Certains thermes fonctionnent encore. J’envisageais de rester en Arkansas quelque temps et de monter dans les Ozarks. Mais il y a une vague de froid venant du nord, et les températures descenderont en-dessous de zéro la nuit et ne dépasseront pas 10 le jour. Voilà la deuxième fois que la température me fait renoncer à un détour lors de ce voyage, et je regrette un peu de ne pas mieux m’être équipée. Je vais à une brasserie goûter une bière locale faite avec de l’eau thermale. Je rentre pompette dormir à un motel dans une toute petite chambre un peu vétuste. Les bâtiments sont peints de jolies couleurs qui contrastent avec les grandes falaises qui dominent la ville.
31 mars
Le gel du matin me fait partir en fin de matinée. La vallée de Hot Springs prend le soleil un peu tard dans sa profondeur. Le soleil printanier est pourtant chaud, mais lorsque le vent souffle, l’air froid rappelle que nous ne sommes qu’aux premiers jours du printemps, et que si les bourgeons se font voir, l’ordre de l’hiver est encore à buter de ses derniers soubresauts. Je ne quitterai pas mon imperméable de la journée, pour me garder du froid. Je suis des pistes forestières, faisant des détours pour m’amuser sur des sentiers étroits entre les arbres. Je passe par le nord du lac Ovadita, puis passe par des chemins très exposés sur des bords de falaises et je dois en faire toute une section à pied, car je crains glisser dans le vide avec mon vélo chargé. Le sol est couvert d’un doux lit d’aiguilles de pin, et les racines des arbres serrent fermement de grosses pierres sombres. Les vallées plus encaissées font pousser des chênes aux troncs forts, et ils sont rabougris sur les flancs exposés aux éléments. Les arbres bourgeonnent timidement, en particulier les pinkbuds, dont les couleurs sont très belles, surtout aux bords des rivières où les eaux sont laiteuses et troubles des sources thermales. Les roches exposées sont couvertes de pollen verdâtre, fin comme de la poussière. Il y a quelques genévriers et des hickory. Les hickorys regroupent beaucoup d' espèces différentes aux États-Unis, dont les pacaniers. Les arbres sont grands et touffus de beaucoup de ramifications, les feuilles épaisses et les pointes portent de grosses noix lourdes. Il y a beaucoup de cerfs de Virginie qui s’effrayent en agitant la queue en sautant dans les taillis.
Lorsque la lumière baisse dans la fin de l'après-midi, le froid commence à mordre, et je perds peu à peu mon désir de camper. Mon sac est confort à 7, limite à 2, et mon orgueil du matin, me présupposant prête à dormir le soir à -2 sans en souffrir, se tarit. J’appelle un motel bon marché en rase-campagne. La maison accolée aux chambres organisées en fer à cheval a des airs un peu hippies, et les tenanciers sont très doux. La patronne me parle d’une source, non loin de là, où l’on trouve des fées certains jours. Lorsque je lui dis que j'avais prévu de camper, elle me dit tenir tant en horreur la nature qu’elle ne désire pas quitter le confort de sa maison, pas même pour aller randonner, elle qui vit ici, dans le centre du massif, loin dans les arbres. Elle a peur des lynx, des bêtes, des bruits, des arbres, de tout ce qui m’est apaisant. Nous nous comparons, moi qui quitte si souvent ma maison pour aller m’aventurer loin, jurant ne jamais revenir et pourtant y retourne la queue entre les jambes au bout de quelques mois, et elle, qui fit ses adieux à son Minnesota natal pour trouver ce lieu qu’elle appela très vite maison, et qu’elle ne quitte jamais.
1ᵉʳ avril
Je resterais des mois dans ces montagnes que je ne me lasserais jamais des lacets et des détours que je pourrais y faire. Chaque flanc offre une nouvelle vue sur les collines qui vont bien au-delà de l’horizon. Les verts et bleus des montagnes dans le froid sont striés des jaunes pales des routes, et parfois, dans les clairières de coupes, les premières fleurs du printemps colorent le tapis sombre des sols par des violets et des roses timides. Je continue ma route, quittant dans la fin de matinée les routes de terre pour une crête qui me mène par les toits des terres d’est en ouest. J’y monte et y descends toute la journée. Les sommets sont couverts de chênes courbés, un peu tristes, abusés par les vents et le froid. Je m’y épuise. La route est vide. Bien souvent, je suis la crête par son côté sud, et au bout d’un moment, je peux deviner la plaine de l’Oklahoma au loin. J’y descendrais en fin d’après-midi. Il y a des chevaux et des maisons au pied des collines. Elles sont dominées par une forte canopée verte de pins qui n’ont jamais été coupés et qui commencent à recouvrir les lieux des humains. Leurs feuillages couvrent le ciel du côté de la montagne si bien que je ne vois plus les sommets d’où je suis descendue, et seulement à ma gauche, au sud, la vue est dégagée vers la très grande plaine. Je remonte le soir vers le massif des Winding Stairs. Je suis entrée en Oklahoma sans en remarquer le panneau. Je campe dans un camping presque désert. Il y a une énorme araignée dans le lavabo du bloc sanitaire qui m’effraie tant que je n’ose pas aller chercher de l’eau pour la nuit, et je n’y retournerai que le matin. Le froid me réveillera dans la nuit.
2 avril
Avant de quitter mon campement (bien après le lever du soleil, à cause du froid), je discute avec un employé du State Park qui me parle des Ouachitas. Big Foot rôderait par ici et frapperait les arbres pour effrayer les promeneurs. Quoi d’autre ferait ces étranges bruits que l’on entend dans la forêt lorsqu’on y est seul ? Parfois, une cacophonie s’entend de toutes parts, comme si les arbres étaient cognés de gros coups par des sonneurs invisibles. Un matin qu’il se promenait avec son chien, celui-ci s’immobilisa et grogna en regardant fixement un point de la forêt. Les oiseaux se turent et le moment dura, jusqu’à ce que le chien reprenne son mouvement, assuré que le danger était dissipé. Il me dit aussi qu’il vit des ovnis, en deux occasions différentes, ici dans les montagnes. Des lumières célestes qui se déplaçaient en virant par angles secs, stationnèrent un temps dans le ciel, puis disparurent subitement. Il connait bien les montagnes et les ermites qui y vivent dans des cabanes qu’ils ont construites de leurs mains, et qui parfois descendent à la ville pour acheter quelques provisions qui leur durent des mois. Il y a des pumas dans les montagnes.
Je prends un café dans le prochain village en regardant les passants, puis je repars pour une nouvelle journée dans un vent de face. Les collines fondent peu à peu dans la plaine. Des pierres dépassent des herbes hautes et pâles. Le paysage devient tout à fait plat, avec des vaches seules et des arbres un peu tordus. Le paysage me rappelle le Kansas, il y a quatre ans déjà. Les rivières creusent le sol en canyons rouges qui éventrent la terre, surmontés de gazons goulus de vert. Je passe par Sardis Lake, un petit point sur la carte, et pourtant si grand. Je suis basse sur mon cintre, la tête abaissée dans le vent. Je croise un cimetière en rase-campagne, loin de tous les habitats, comme si les morts avaient leur propre village au milieu des plaines. Je m’y arrête pour m’abriter du vent. Je m’en suis un peu énervée et je me mets du mieux que je puisse derrière les mausolées les plus cossus qui surplombent les grands caveaux des familles afin de me protéger. Je m’arrête vers Atoka, saoûlé du vent.
3 avril
À mon réveil, je ne savais pas si le vent serait à nouveau contre moi à ronfler contre les oreilles et à me battre jusqu’à l’arrêt, et je me préparais à subir mon sort. Le vent se déclara de côté, mais orienté un peu dans mon dos, si bien qu’il me poussa tout du jour lors des moments où ma route me faisait bifurquer sensiblement vers le nord. Les routes des plaines sont tracées en quadrillage sur un plan nord-sud-est-ouest, et peu de routes, probablement tracées sur d’anciennes voies indiennes ou coloniales, dérogent à cette règle. Je parcours ainsi 190 kilomètres jusqu’à Duncan. Des puits de pétrole marquent parfois la prairie de leurs figures sombres. Je m’arrête dans un hameau plat, avec un parc de jeux désolé. Je m’y installe pour déjeuner à l’abri du vent sous un porche en béton. Des enfants passent et jouent. Je suis dans la partie de l’Oklahoma qui forme un manche de casserole. Je croise dans la plaine des maisons effondrées, écroulées de côté et reprises par les herbes de la prairie. Je pense au Oklahoma Land Run (et à Ruée sur l’Oklahoma, l’un de mes albums préférés de Lucky Luke). J’y suis.
Il y a de belles couleurs à Arbuckle et, plus à l’ouest, je traverse en roue libre, poussée par le vent, une ville de raffineries, où des monstres de métal crachent dans des souffles des flammes par des hautes cheminées, comme si j’avais surpris un trou qui mènerait droit aux enfers. L’odeur du pétrole englue l’air que je respire, les creux collineux où ils se cachent sont funestes. Les tuyaux et les rouages, les fumées et les suies qui se soulèvent dans le vacarme offrent un spectacle comme l’on aurait cru lire dans les Révélations de saint Jean. Plusieurs fois dans ma vie, la vue des raffineries infernales occupera des paysages de mes rêves, où je serais poursuivie par des forces maléfiques qui me cracheraient des flammes, et je m’échapperais en grimpant aux échelles rouillées et en courant sur les tuyaux bouillants dont l’écho résonnerait sous mes pas et trahirait ma présence à mes ennemis fantasmagoriques.
J’arrive à Duncan (« Hear it not, Duncan, for it is a knell / That summons thee to heaven or to hell. ») et me ravitaille pour la nuit.
4 avril
Je ne roule que la matinée, pour atteindre Wichita Falls. Je parcours les parcelles carrées d’une dizaine de kilomètres de carré qui rythment la région. Certaines parcelles de prairies sont cultivées, et sur d’autres je vois du bétail. Je flâne en suivant les routes de terre quadrillées, plutôt que les diagonales de bitume qui coupent la grille et m'amèneraient droit à destination. Près d’un hameau de mobil-homes, deux bull-terriers me prennent en chasse, et je ne peux pas les semer. Je tire à la bombe au poivre en plein dans les yeux du premier, alors qu’il est presque à mes mollets. Cela l’arrête net. Mon tir est si bon que je le vois, par-dessus mon épaule, aller se frotter le museau dans le gazon pour soulager la douleur. J'accélère le pas, par crainte du propriétaire du chien, car tous sont armés ici.
Il y a une fête à Wichita Falls, et je passe l’après-midi dans les rues décorées. Je suis maintenant au Texas. Je vais dans une cantina pour manger une quesadilla délicieuse. La nourriture chaude m’avait manqué. Je flâne. Les paysages plats des plaines du matin m’ont rappelé les premiers jours de mon premier voyage, il y a quatre ans au Kansas. Cette ville rouge et beige de l’Ouest aussi. Je lui écris l’après-midi un mail, par une soudaine nostalgie, afin de lui donner des nouvelles et en prendre, pensant encore que je le reverrai peut-être un jour. Mes articulations se plaisent à déambuler dans les rues l’après-midi, à faire des mouvements qui les détendent et qu’elles commençaient déjà à oublier, crispées des montagnes et du vent des jours précédents.
5 avril
Alors que je pensais passer ma journée dans des plaines rébarbatives, à traverser le nord du Texas, je me plais à rouler dans de multiples types de prairies et de champs différents et me régale des variations. Il y a des champs d’éoliennes dans la plaine, quelques zones de puits de pétrole, et je vois des traces de coyote dans la boue séchée. Je verrai deux coyotes dans la journée, sur des routes de terre. Le second marchait vers moi sans me voir, avant de relever la tête et de prendre la fuite. La terre est d’un rouge sombre qui contraste avec les herbes grasses et très vertes. Il y a des failles qui éventrent la terre, au fond desquelles passent de petits rus. Je me penche au-dessus des rivières sur les ponts, et je vois parmi les cailloux ronds des tortues. Dans les plaines, il y a des sortes de petits chênes rabougris et tordus, sous lesquels des pécaris fouissent sans trop faire attention à moi. Les plaines se couvrent de petits buissons épars de jaunes et verts pales, parfois de turquoises effacés, et le printemps y fait fleurir des pointes de violet et de bleu (comme la bluebonnet, la fleur emblème du Texas). Je croise un hameau complètement abandonné, où les maisons se sont enfoncées de côté et les herbes hautes poussent dans les jardins. Seule la dernière habitation de la rue semble encore vive : derrière des grillages se trouvent de gros cochons noirs.
Je suis des pistes de gravier ou de terre, et parfois le terrain se mue en sable, si mou qu’il n’est plus possible d’y rouler. Dans la grande plaine, je prends alors conscience que je suis bien loin des villes et des villages, et que marcher jusqu’à destination en poussant mon vélo ne sera pas possible. Je rebrousse alors chemin. Je vois des éoliennes au sol, en attente de montage, certaines pièces encore emballées. Des petites alouettes fusent, et des faucons attendent perchés sur les hauts poteaux électriques. Parfois, au milieu de l’immensité, quelques arbres bien portants sont groupés en un taillis resserré. De l’eau doit y passer.
Je croise une première ville après 120 kilomètres. Je mange en discutant avec une femme à la station-service. Crommel est une ville de moins de 1000 habitants, et les opportunités de carrière y sont maigres, me dit-elle. Après 200 kilomètres, j’atteins Paducah. Il est 17 h et il fait très chaud. Je m’arrête à une station-service au porche en tôle qui sent la friture. Un homme vient me parler, il chasse dans la région. Je lui parle des pécaris que j’ai vus. Je ne connais en anglais que leur nom hispanisant : « javelinas ». Il semble surpris de m’entendre les appeler ainsi, mais comprend. Les bâtiments aux alentours sont des tas de briques un peu vétustes, beiges de chaleur sous le ciel bleu. Je mets ma boisson fraîche sur mes genoux dont les ligaments sont un peu endoloris. Je repars après une heure pour la réserve naturelle de Matador. C’est un bout de collines escarpées et rougeoyantes, couvertes de différentes sortes de mesquites, de genévriers pâles avec des baies rouges, et de buissons piquants de toutes les formes. Je suis des routes de terre à bétail, passe plusieurs canadiennes. Des traces de sabot sont imprimées dans la boue sèche sur les bords de route. Les collines sont étroites et les routes sinueuses, donnant l’effet d’un labyrinthe dont on ne voit pas l’issue. Au loin, je vois une crête que je pense devoir passer, et les routes m’y mènent, mais toujours louvoyent pour finalement me la faire longer de loin. Les routes de ma carte n’existent pas forcément, et je tourne plus d’une heure sur des voies qui m’éloignent toujours. Parfois, elles deviennent d'un sable de plus en plus profond et difficile à naviguer, entre des pâturages désolés. Un orage pointe à l’horizon, le ciel se noircit des lourds nuages et du crépuscule. J’atteins un état d’épuisement confus, où l’on se perd dans les décisions que l’on souhaite prendre à présent, celles du passé et celles qui ne sont désormais plus envisageables. L'acronyme STAR me vient en mémoire : STop Assess Respond. Je m’arrête alors, m’assois, mange toutes mes provisions en évaluant la situation. L’orage au loin forme une nuée indigo d’un bleu si profond qu’il semble amener dans les fourmillements des dernières lueurs un lé de pleine lune déchiré de velours. Je décide de faire demi-tour et de retourner à Paducah. Je vais à un petit hôtel, ressemblant davantage à une ancienne chambre d’hôte, avec un fronton de pierre gravé. Je conte à la tenancière mon errance. Son mari est wildlife manager dans la réserve. La nuit, l’orage est long et fort, plusieurs fois les pluies violentes et la lumière des éclairs me réveilleront dans ma chambre. Je suis heureuse de ne pas dormir dans la prairie. Le lendemain, je suis réveillée un peu avant l’aube, et j’écoute de mon lit le bruit de la pluie qui tombe toujours.
6 avril
La pluie cesse et je suis déjà prête à partir. Lorsque je saisis mon vélo, je me rends compte que mes deux pneus sont à plat. Les épines des buissons (« goatheads ») qui bordaient les routes rouges de la réserve sont probablement en cause. Je change mes chambres et constate que je n’ai, en plus de mes deux chambres supplémentaires, plus qu’une rustine. Je pars un peu plus tard, et fais un détour à Childress pour en acheter des supplémentaires au Walmart. Il n’y en a pas, seulement du Slime, une sorte de faux liquide anti-crevaison réputé pour son inefficacité, et des chambres à air de 26 pouces. J’ai attaché mon vélo devant le Walmart, et un passant me dit qu’il n’y a nullement besoin de cadenas ici. Je lui réponds ô combien je me sentirais bête, ici au milieu du Texas, à devoir appeler ma mère pour lui dire que l’on m’a volé mon vélo et qu’il me faut de l’argent pour rentrer.
Je crève à nouveau un peu plus loin sur un bord de route et je remplace ma chambre. Je devais emprunter une piste de terre (probablement une ancienne voie ferrée locale), mais, à peine sur le sentier, je vois qui poussent dans la poussière jaune de petits cactus aux épines bien fournies, et je retourne sur les routes de bitume pour ne pas tenter la fortune plus que de raison. Je crève encore deux fois, un peu plus tard. Je n’en crois pas ma guigne. Après réparations, il ne me reste ni chambre ni rustine. Je suis encore bien loin de Lubbock, grande ville où il y a plusieurs magasins de vélo. Chaque crevaison me prit 30 minutes, à poser des rustines en dégoulinant de sueur sous le soleil du bord de route et à regonfler mes pneus, déjà cinq fois aujourd’hui, avec ma petite pompe. Je crains à présent la prochaine crevaison. Il ne me restera plus qu’à tenter de nouer la chambre sur le trou, en espérant que cela perde assez doucement ainsi pour me mener en ville. Au train où je vais depuis le matin, il me semble que je ne tiendrais pas 20 kilomètres sans crever à nouveau. Je décide de rester sur la grande route : si j’y crève, je pourrais trouver quelqu’un pour m’emmener les 100 kilomètres qui me séparent de Lubbock.
J’arrive à Turkey, petite ville au drôle de nom. Je me rends à la station-service et à la quincaillerie, espérant pouvoir trouver des rustines, mais il n’y en a pas, pas même pour tracteurs. Il est tard. On m'envoie à l’hôtel, là où je pourrais camper. Je descends de la rue principale vers l’arrière du bourg en contrebas, duquel on voit non loin l’escarpement du Caprock. C’est la limite géographique qui délimite le Llano Estacado, à l’ouest d’ici. L'hôtel date de 1927, son architecture est de style renouveau colonial espagnol, avec des couleurs ocres, des colonnades surplombées par des arcs et des coursives aux étages. Il se passe le début d’une fête dans le grand jardin. Une petite scène est installée, avec des lumières et un très grand barbecue. Il y a une superbe Airstream sur un côté. Je suis guidé par le propriétaire et sa femme là où je peux camper, au fond du jardin. Ils m’assurent que je trouverais quelqu’un pour m’emmener à Lubbock le lendemain et m’invitent à me joindre à la fête. Mon histoire paraît bizarre, je suis un peu gênée dans mon honneur à demander un service pour cinq crevaisons infortunées comme si j’eusse été sans ressources et incapable. Je monte ma tente et me mêle à la fête. Je vois une demande en fiançailles. On me confie que l’homme est fraîchement divorcé, trop récemment pour la bienséance, et à l’arrière de la foule, on prend même des paris sur la durée de l’union.
Je reste une bonne partie des festivités avec une fille de 18 ans qui me partage beaucoup de sa vie et de ses pensées sans pour autant demander en retour les miennes. En elle, je découvre un exemple curieux des mœurs des jeunes de la campagne texane. Elle vit dans un mobil-home avec sa famille, mais se distingue bien de ceux qui vivent dans les trailer parks, surtout ceux des villes pétrolières, ravagées par la méthamphétamine. Elle a foi en beaucoup de choses, dont il ne me semble pas distinguer de hiérarchie distincte. J’aurais eu tendance à croire qu’il est universel dans tous les systèmes de pensée d’associer à chaque notion un degré de vérité et de probabilité, et de combler seul le creux de l’inconnu par de la croyance. Chez elle, il semble que Dieu, les fantômes et le système métrique sont à un même niveau de connaissance et de foi, sans pouvoir discerner avec assurance une différence entre ce qu’elle ne sait pas, ce qu’elle ne comprend pas, et ce qu’elle ne croit pas. Je tente de lui expliquer comment fonctionnent les degrés Celsius, sans succès, car la notion d’échelle entre deux points définis lui semble absurde. Je refuse poliment la viande que l’on m’offre et je fais face à beaucoup d’incompréhension lorsque j’explique ne pas en consommer. La fille me dit « I liked you until now », d’un air pince-sans-rire, mais sans remettre en question ses conceptions et ses jugements de valeur. Elle ne distingue pas la différence entre végétarien et vegan (ou semble si assurée de ce qu’elle sait qu’elle ne prête pas attention lorsque je nuance les deux notions). Certains Texans sont intéressés lorsque je leur explique plus amplement la gestion nutritionnelle végétarienne et mes sources de protéines. Mon corps musclé vient à l’appui de mes dires, peut-être est-il mon meilleur argument. L’américanocentrisme est fascinant. Le monde n’existe pas au-delà du Texas, l’étranger est une province lointaine, comme un monde de rêve où tout se confondrait en une irréalité fantaisiste. Je ne connais pas Merle Haggard, et ils en haussent les sourcils en ouvrant la bouche, comme si je n’avais pas entendu parler des saints ou des prophètes, ou des premiers présidents qui ornent les billets. Merle Haggard est un chanteur de country.
La jeune fille se définit à moi, peut-être un peu avec orgueil, par les diagnostics psychologiques qui lui ont été posés lorsque sa famille l’emmena chez le médecin. L'anxiété et la dépression sont vues comme des tares personnelles, médicamentables, et non comme une corrélation de fragilités personnelles et de facteurs sociaux exogènes. Face au diagnostic, l’individu est classé comme déficient et, par conséquent, médicamenté pour pallier ses faiblesses. L’aide psychosociale est ridiculisée, car ne faut-il pas être fort face à un monde rude ? Chercher à changer les conditions de vie qui rendent le jeune individu malheureux serait accepter que le modèle social et familial que l’on lui donne n’est pas adapté, tandis que rejeter sur lui son incapacité à être heureux permet de ne pas remettre en question le système dans lequel il évolue. Vers minuit, j'aperçois son petit frère, fatigué et qui semble prêt à pleurer de tout le bruit et l’agitation de la fête. Je vais le voir et je reconnais l'inquiétude et l’angoisse que moi-même ressentais à son âge lorsqu’on me faisait rester tard avec des adultes bruyants. Je demande à sa sœur s’il ne faudrait pas le coucher, mais sa mère, son beau-père (un homme hirsute, large et gras), tous semblent ignorer sa détresse, et lorsqu’il pleure de fatigue, sa mère rit de lui. Je ne peux que m’agenouiller auprès de lui, et lui dire de venir s'asseoir loin du bruit, en attendant que sa famille décide de rentrer chez elle. On me paye des bières toute la soirée. Je crois comprendre, sans que ce ne soit très clair, que le chanteur et guitariste qui joue rentre à Lubbock le lendemain et pourra nous prendre en voiture, moi et mon vélo. Je retourne à ma tente avec ma bière entamée après la fête et la renverse accidentellement dans ma tente. Je dors dans l’odeur collante du houblon.
7 avril
Le matin, je déjeune de pancakes avec Danny, le musicien, et sa fille Molly. Pendant qu’il range son matériel, je fais des poiriers et des roues avec elle. Je lui montre comment s’articulent mes cales de vélo sur les pédales. Son animal préféré est le guépard, comme moi. Nous chargeons mon vélo à l’arrière du pick-up de Danny et partons en fin de matinée. Nous sympathisons sur la route. Il est très drôle. Il me parle de son divorce et de la situation avec sa femme. Bien que les villes y soient libérales, le cœur du Texas et son système de justice demeurent conservateurs.
– Au Texas, il faut qu’une femme soit en train de taper de la coke dans les toilettes du tribunal pendant l’audience pour qu’un juge décide de lui retirer la garde de ses enfants et donne sa préférence au père.
Sa fille est en garde partagée et il doit la déposer chez sa mère en arrivant à Lubbock. Nous traçons dans la plaine. J’entends un bruit curieux dans l’habitacle : c’est le vent qui ronfle dans les portes.
Nous montons le Caprock. Le mur de falaises fait presque 300 mètres de haut, et nous le voyons s’étendre de part et d’autre de la plaine. Nous nous arrêtons en haut pour admirer la vue et jeter des petits cailloux dans le canyon. Danny rappelle à sa fille de prendre garde aux serpents à sonnette. Du haut du Caprock, nous sommes sur le Llano Estacado : une plaine en faux-plat qui forme un plateau de 300 kilomètres de long, entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Le mot « caprock » désigne lorsqu’une couche de roche dure surplombe une couche sédimentaire moins dense. J’aurais aimé faire cette ascension à vélo. Les plaines sont ici à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Nous sommes dans la zone de l’aquifère Ogallala, qui donne un sol riche pour être cultivé. Des champs s’étendent de part et d’autre. Je vois des céréales et du coton. La surutilisation de la nappe phréatique causa des problèmes environnementaux par le passé, et les agriculteurs locaux tentent de passer à un modèle d'exploitation plus durable. Nous nous arrêtons pour aller voir un champ d’éoliennes.
Danny m’explique que nous sommes en terre comanche et me conte une histoire. Les Comanches volèrent aux colons les mustangs, apprirent à les monter et à les dresser et devinrent les plus furieux des guerriers indiens. Son arrière-grand-oncle fut capturé par des Comanches, tandis qu’il chassait avec son cousin. Le cousin fut tué sur le coup, et l’oncle blessé d’une flèche dans la cuisse. Les Indiens le couchèrent nu sur une carcasse de veau dépecé, elle-même montée sur un cheval, et l'emmenèrent sous le soleil loin dans la plaine. Sa peau blanche brûla jusqu’à s’arracher et mettre sa chair à nu. Il resta prisonnier et fut utilisé comme serf. On se servit de lui comme cible de tir et lui infligea toutes sortes de tortures et d’humiliations. Danny m’explique que les Comanches, en testant leur corps et leur mental, sélectionnaient ainsi parmi les colons blancs les plus forts pour en faire des leurs. Les maladies et la colonisation avaient fait chuter les naissances et augmenté la mortalité infantile, et les Indiens tentaient de renouveler leur population par le rapt. Son arrière-grand-oncle retrouva sa famille quelques années plus tard et raconta son histoire.
Nous déjeunons dans une cantina à Lubbock. Je mange une délicieuse enchilada aux courgettes, et je fais une casemate de menus et de salières avec Molly qui s’ennuie. Danny me propose de dormir chez lui après ma visite au magasin de vélo.
Au magasin de vélos, je sympathise avec le mécano. Nous sommes dimanche, il est seul à gérer le magasin et a la conversation facile. J’achète de nouvelles chambres car les miennes sont trop rapiécées. Je mets également du liquide anti-crevaison dans celles qui sont montées, espérant que cela préviendra les petites crevaisons. Je me promets de passer en tubeless à mon retour. Je le prie également de purger mes freins : ils prennent à nouveau du mou. Des clients entrent alors qu’il entame la purge et il me demande si je peux les aider tandis qu’il finit son travail. Le temps de la purge, j’accueille et je conseille les clients. La première cherchait des renseignements pour un vélo de bikepacking (elle était bien tombée), les deux autres à regonfler un pneu et acheter un cadenas.
Je rejoins la maison de Danny. Lubbock est une ville plate dans la plaine sèche, et les maisons des quartiers résidentiels ont des airs mexicains. Son voisin de patio, musicien également, est là et me dit que Danny arrivera bientôt. Je discute un peu avec lui en attendant. Il s’appelle Jim, a une voix grave superbement grasse et un accent du sud. C’est un plaisir de simplement l’entendre parler de cette voix qui berce. Dans l’ouverture de sa porte, j'aperçois un bong et un pochon d’herbe. Jim me conseille, lorsque j’atteindrai Roswell au Nouveau-Mexique, d’aller déjeuner au Stellar Café. Je prends note. Danny arrive et me montre sa maison. Il a un grand piano à queue dans le salon. Il me propose de tirer sur son bong, me disant avoir fumé de l’herbe toute la journée depuis qu’il a déposé Molly chez sa mère. J’ai du mal à maîtriser le dosage avec un bong, et comme à chaque fois, la première bouffée semble trop peu, et la seconde semble trop. Il me montre un trésor : une grande boîte de curieux chocolats en forme de canard, enrobés dans du papier métallisé jaune, à la psilocybine. Nous allons promener son chien dans le verger de pacaniers derrière sa maison. Je campe dans son jardin et je pars tôt le matin pour m’éviter la chaleur de l’après-midi, après lui avoir dit au revoir.
8 avril
Je dois atteindre vite Roswell, la prochaine ville, car de violents vents venus de l’ouest balaieront le désert à 70 km/h dans deux jours, et pour deux jours. Je compte m’abriter à Roswell le temps que la tempête passe. Déjà, le vent forcit un peu contre moi durant la journée. Le Llano Estacado est un faux-plat, et avec le vent de face, je suis à 17 km/h de moyenne. Ma route n’est qu’une longue ligne droite vers l’ouest à travers la plaine. Je n’ai rien à faire, rien à regarder. J’écoute la version audio de la BBC de L'Empire contre-attaque pour passer le temps. Les cultures laissent place à des prairies d’herbes pâles qui me rappellent le Wyoming, mais en plat. Quelques puits de pétrole et des troupeaux éparpillés ça et là me font tourner la tête. Je vois des antilopes courir dans la plaine. La fourrure dense et blanche de leurs fesses forme un cœur. J’arrive à Tatum (dont je ne sais prononcer le nom) et décide d’y rester, car, à l’arrêt, le poids du soleil et de la chaleur se font sentir. Je ne trouverai pas d’eau entre ici et Roswell. La vue du désert me rappelle les vagues souvenirs de l’hiver où je fus frappé d’une intoxication alimentaire au milieu de l’immensité. Des images, faux souvenirs ou vrais, je ne saurais dire, me viennent puis disparaissent brusquement. J’avais été si épuisée que ma mémoire n’en a rien imprimé, sauf des bribes qui paraissent irréelles. Les photos que je conserve de ce voyage sont aussi étranges qu’elles me sont inconnues : aucune d’elles ne me rappelle quoi que ce soit, comme si j’avais en ma possession les photographies de voyage d’une autre. Mes doigts, mes mains et mon dos me font mal d’avoir été courbés en position basse sur mon cintre toute la journée.
9 avril
Je pars très tôt, car le vent se lèvera pour de bon dans l’après-midi. Après une trentaine de kilomètres, j’atteins le bout du Llano Estacado. Il se termine en une falaise, et je vois en contrebas tout ce que j’ai monté en pente invisible. Je descends dans une nouvelle plaine désertique, aussi pâle et infinie. Je fais les 120 km pour Roswell rapidement, avec un peu d’eau et presque plus de nourriture. En bas de la plaine, le vent est différent, et le sol plat : à la même puissance, j’avance plus vite que sur le Llano, et je n’ai plus cette impression frustrante d’avancer si peu tandis que je pédale fort.
Je vois quelques escarpements très rouges, canyonneux, près du Bottomless State Park, et passe « à l’ouest du Pecos ». Roswell est connu pour être le lieu de l’affaire de Roswell : la chute d’un ovni dans le désert dans les années 40. Des ufologues continuent de visiter la ville, et il y a chaque année un festival d’ufologie. Quelques magasins ont des airs de soucoupe volante des années 50, dont le MacDo de la ville. Comme me l’a conseillé Jim, je vais directement au Stellar Café en entrant en ville, tandis que le vent s’intensifie. En dix minutes, j’ai un café, une quesadilla aux œufs et aux légumes, et sympathisé avec Dan, qui tient le café et qui m’a aussitôt invité à loger chez lui et sa femme Megan pour les trois prochaines nuits. Je fus déstabilisé en regardant son visage lorsqu’il prononça « ma femme », car il semble à peine moins âgé que moi. Je ne sais pas si j’ai déjà rencontré des gens plus jeunes que moi mariés. Je vais au musée l’après-midi, écrasée par la chaleur. Je laisse mon vélo dans l’entrée, sous la garde des deux réceptionnistes. Le soir, je vais chez Dan et Megan. J’ai acheté des bières en canette, dont l’aluminium est si fin que deux d’entre elles se percent en chemin dans le sac plastique suspendu à mon cintre. Je suis rapidement comme partie intégrante de leur groupe d’amis, nous nous entendons bien. Je passe deux bons jours à Roswell. J’écoute le récit de leurs vies. Megan travaille avec des chiens au centre social, et trois d’entre eux sont dans la maison. Ils viennent d’emménager, ayant trouvé récemment cette maison en banlieue de Roswell, dans un quartier poussé au milieu de la plaine, d’où on voit par la fenêtre les antilopes et les vergers de pacaniers. J’admire leur aptitude à la vie. Dan projette d’ouvrir un petit magasin de réparation de vélo à l’arrière du Stellar Café.
10 avril
Je vois ma première tempête de sable. Le ciel est d’une couleur apocalyptique, et les grains fins viennent brûler les yeux, les poumons et les oreilles. Dans la rue, tous sont couverts pour se protéger par des masques et des lunettes. Les arbres sont secoués à en déchirer les branches et des nuages se soulèvent dans les rues. Je vais voir le musée d’art contemporain de Roswell. Il y un programme de résidence artistique et des œuvres des anciens résidents sont exposées. Je suis impressionnée par certaines peintures de paysages de Don Anderson, le fondateur du musée, grandes, simples, presque voluptueuses. Je mange à midi avec Dan à un food truck mexicain. J’ai du mal avec l’accent mexicain en parlant espagnol. Le soir, je bois des verres avec Megan et écoute l’histoire de sa vie, dure, et raconte peut-être un peu trop de la mienne.
11 avril
Deuxième jour à Roswell. Le vent a faibli. Je passe la matinée au café à rattraper mon journal. L’après-midi, nous allons à l’est en voiture, dans le désert sur les falaises, et marchons jusqu’à des sinkholes aux airs d’impacts de météorites. Leur voiture est une japonaise petite comme une Toyota Yaris, le plus petit véhicule que je verrai de mon voyage. Serrée à l’arrière du siège qui se rabat, je m’y sens comme en Europe. Le ciel au-dessus du plateau est immense. Il y a des biches dans les hautes herbes d’un cratère. Je marche avec une paire de Nikes que j’ai achetée pour 10 dollars à l’Armée du Salut la veille. Je trouve un bois d’antilope que j’offre à Dan. Nous cherchons des « pecos diamonds », de jolies petites pierres translucides d’un blanc violacé ou rosé. Megan en fait des bijoux. C’est un beau jeu. Je leur donne tout mon butin, sauf une que je garde avec moi dans mon porte-monnaie.
12 avril
Dan m’accompagne à vélo vers l’ouest pour les deux premières heures, avant de rebrousser chemin à temps pour son service. Nous continuons la grande ligne droite qui m’avait mené à Roswell il y a trois jours. Nous nous séparons au sommet d’une petite montée, près d’un ancien silo de missile enterré qu’il m’indique dans la plaine. Les nombreux silos du désert, maintenant inutilisés, sont vendus à des particuliers. J’ai quitté la terre rouge pour la pierre blanche et jaune de craie.
Sur le chemin de Ruidoso (« ruisseau bruyant »), j’emprunte à nouveau des routes de terre. Je quitte la plaine pour des petites montagnes, qui forment un tout petit massif adjacent aux Rockies, séparées d’elles par une grande plaine. Des vaches ont de larges cornes, et je vois quelque chose qui ressemble à un caca d’ours. Une petite averse tombe gelée (il fait froid depuis le matin). Le sable et les cailloux blancs, avec des buissons épars, me rappellent le Sud-Ouest et la garrigue qui bordent le sud des Cévennes. Je suis pourtant bien loin de la mer, ici. Je prends mon temps car la journée est petite. Je grimpe dans des pins sur des tapis de genévriers. Ma route suit brièvement un flanc sec sur une piste étroite. Par-delà des arbres à ma droite, je vois loin dans une vallée à l’ouest. Après un tournant, j’arrive à une ouverture dans la canopée et je découvre, dans une lumière fabuleuse, une chaine de montagnes qui se dévoile à moi par-delà la vallée. La lueur de la journée froide en fait ressortir les ombres, comme douces et coulantes sur des flancs arides et buissonneux, et je sens en moi une soudaine attirance sensiblement charnelle pour ces montagnes. Mon désir, quasiment absent depuis maintenant longtemps, se trouve réveillé par ces courbes voluptueuses, comme un corps dans un lit recouvert d’un drap fin. Je les contemple quelques minutes, surprise des remuements de mon corps. Je m’en souviendrai, qu’un jour j’ai ressenti pour une montagne plus que je n’ai jamais ressenti pour aucun homme.
Je suis à plus de 2000m. Il me semble que respirer est un peu plus dur que la veille, mais peut-être l’air est-il fin à cause du froid. J’arrive à Ruidoso. À Lubbock, un homme qui passait au magasin de vélos m’avait donné l’adresse d’une cabane où dormir. Je sors le papier de mon portefeuille et vais à l’adresse. Je ne trouve qu’un sombre cabanon de jardin à l’arrière d’une maison en zone urbaine. Je renonce et vais à un motel surprenament bon marché. Des chutes de neige sont annoncées pour la nuit. Dans mon lit, je regarde à la télé Being There, avec Peter Sellers. Je comprends soudainement la référence « I like to watch » que j’ai tant entendu parodiée.
13 avril
Il neige un peu à mon réveil. J’ai rendez-vous au White Sand Monument ce soir avec les gens de Roswell pour aller y camper (nous sommes samedi). Je pourrais descendre du petit massif par l’ouest et aller directement par la plaine au sud, simplement et directement. Néanmoins, je décide de continuer ma flânerie dans les montagnes de la Lincoln National Forest avant de traverser la vallée. En route, je croise un troupeau de wapitis et des chipmunks. Je traverse la réserve Mescalero dans les pentes douces entre les pins et les éboulis. Les routes sont bordées de barbelés. Il n’y a pas de véhicules.
Tandis que je continue mon ascension, le ciel se couvre et des averses de petits grêlons me frappent le visage. Les grêlons rebondissent sur mon kway et ne me mouillent pas. Je passe par des vallées aux herbes hautes, jaune pale, sous les pins. La neige de la nuit tient encore au bout des longues branches et sur les coteaux ombragés. Elle tombe parfois des rameaux en un bruit duveteux. Je monte jusqu’à 2750m. J’ai rarement été aussi haut. Je croyais que c’était le plus haut de ma vie, mais après vérification faite à Cloudcroft, Hoosier Pass était à 3200m. Il est normal que j’y fusse gelé à Alma cette nuit-là !
Une forte grêle commence, tandis que j’approche de Cloudcroft. La route et le ciel sont rapidement obscurcis. Je ne vois plus. La surprise me fait rire dans la nuée. Les grêlons tombent si fort qu’ils rebondissent et sautent partout devant moi. J’entre en ville et me réfugie deux heures au café. Dehors, la grêle se mue en une neige qui tombe à bon rythme et subsiste au sol. Des enfants font des batailles de boules de neige. De ma fenêtre, je vois les véhicules du parking se couvrir d’un manteau d’une vingtaine de centimètres. Je discute un peu avec des gens de Lubbock (j’ai reconnu leur accent texan) et le sheriff du coin qui passe prendre son café. Ils sont peu étonnés de l’épisode rapide. Je profite d’une ouverture de ciel bleu pour entamer la descente vers la plaine. Quel changement brutal ! Je passe du paysage alpin à des canyons de brousailles éparses, ponctués de mamelons jaunes. La plaine, loin en contrebas, paraît bleue. Les plantes sont assez vertes, et les canyons ont ces bords tranchants en étages, semblables à des pyramides incas. Je dévale vers Almagordo en tremblant de froid sur mon vélo, puis, une fois arrivée dans la plaine, à peine une heure plus tard, je suis en t-shirt sous un soleil de plomb, poussée par le vent dans la plaine droit vers White Sands.
L’endroit porte bien son nom. Je n’en crois pas mes yeux. C’est un désert de sable blanc, fait de gypse. Les dunes se chevauchent jusqu’à une muraille de montagnes bleutées à l’ouest. Le sable est si blanc que je ne peux pas lire en roulant la piste de sable tassé qui passe à travers les dunes. Je vois les averses avancer dans le grand ciel et se déverser dans le désert, loin. J’arrive à une barrière de rangers. L’entrée est réglementée afin de protéger les dunes. J’y attends les Roswelliens qui arrivent en voiture cinq minutes après moi. Ils se garent et je mets mon vélo en sécurité dans leur voiture avant de les suivre à pied dans les dunes. Des poteaux plantés, et sans cesse renouvelés avec le mouvement de la mer de sable, guident nos pas dans les dunes pour nous mener au creux où nous camperons. Le sable n’est pas aussi mou que je ne le pensais, et dans les plats il y a même des plantes, des herbes hautes et de petites plantes grasses aux fleurs violettes avec des cloportes. Nous installons nos tentes et allons jouer dans les dunes, à sauter et à dévaller en roulant. Le sable est si fin. Mes cuisses me font un peu mal lorsque je fais des plats. Dan a une étrange pâte au THC. On testa des bombes à hydrogène dans ce désert, plus au sud, et sur ma carte sont encore indiquées les zones de pilonnage. Le froid vient vite avec la nuit, bien que le vent se soit arrêté. J’ai froid la nuit dans ma tente.
14 avril
Il y a du gel sur ma tente et ça ne m’étonne pas. Je me lève avant le lever du soleil et grimpe au sommet d’une dune pour voir le jour apparaître. Les montagnes de l’ouest prennent des couleurs et des ombres époustouflantes. Nous partons tard après un petit déjeuner chaud dans le sable. Je dis au revoir aux Roswelliens pour la seconde fois, après avoir légué ma paire de Nikes à une de leurs amies pour son fils qui fait du 40. Je n’aurai plus à marcher pendant un bon moment.
J'écope d’un vent de face dans la grande plaine et le petit col qui mène à Las Cruces. Les montagnes sont escarpées de beige, et du haut (environ 1600m), je vois bien la ville et la plaine fertile du Rio Grande. Je m’arrête brièvement à un magasin de vélo pour acheter un nouveau pneu arrière. Il est 15 h et la chaleur du soleil est trop forte pour ma peau. Je vais manger une grosse glace à Sonic’s en attendant de repartir. Je remonte le Rio Grande par le parc de Radium Spring. La terre marron, les montagnes sèches et les maisons basses aux petites fenêtres et aux murs épais me rappellent l'Espagne. Je campe illégalement dans le state park à un emplacement de pique-nique. Je suis tranquille sous l’auvent, et j’ai même une table. Devant moi, je vois le fleuve en contrebas et les montagnes de l’autre côté. Je ne plante même pas ma tente, mais installe simplement mon matelas sous l’auvent, à l'abri des bourrasques du soir. Une voie de train et des coyotes hurlent la nuit.
15 avril
Je pars à l’aube avec plaisir : il fait chaud dans le matin. Je remonte le cours du Rio Grande, puis m’enfonce à nouveau dans les montagnes à l’ouest. J’ai atteint les Rocheuses. Elles apparaissent bleues encore loin sur la prairie, puis de près, rouges avec des touffes de pins.
Le vent de face se lève en fin de matinée et, avant de sortir de la plaine, je m’arrête à l’ombre d’un panneau d’information surmonté d’un petit porche pour un encas. Un homme s’arrête en pick-up et vient me parler. Après quelques phrases de politesse, il me parle de Jésus. Je m’attends d’abord, peu surprise désormais par la tradition prosélytique américaine, à un sermon rapide sur l’amour du Christ. Cependant, l’homme entame une diatribe de vingt minutes, non pas sur l’amour christique, mais sur le péché, l’enfer, et la nécessité d’implorer le pardon au Seigneur. Je ne peux m’en dépêtrer. En me regardant dans les yeux, il me dit : « Toi aussi, tu es pêcheuse, par nature, mais si tu crois en Jésus, tu seras sauvée. » Cela me met en colère, sans que je ne le montre. Tenter de semer la crainte et menacer d’un enfer pour vendre ensuite le salut au prix de la foi est abject. La doctrine du péché originel est si malsaine, car si la foi aveugle rachèterait tous les péchés, à quoi bon être une bonne personne ? Il n’y a aucune place pour la morale et le libre arbitre. Cet homme insiste sur mes péchés, pointant du doigt ma personne, se faisant juge de tout (à l’encontre des préceptes du Christ : « Judge not, that ye be not judged. »). Je parviens enfin à m’en débarrasser après une vingtaine de minutes et continue ma route en ronchonnant. En plus d’avoir perdu ma bonne humeur, le temps qu’il m’a dérobé a laissé le vent et la chaleur forcir.
Je grimpe dans la gueule des montagnes et m’arrête à Hillsboro, un beau village minier. Je commande un burger au petit restaurant en discutant avec deux charmantes femmes. Un papy en chapeau de cowboy, Lonnie, me paye mon repas et nous discutons le temps que je mange. Le restaurant est décoré d'objets anciens, et le comptoir de bois massif m’impressionne. En sortant, je parle également avec un charpentier du coin. Il a déménagé ici de New York, cherchant une vie calme. Il déplore l’absence de jeunes : à 61 ans, il est le 3ᵉ plus jeune pompier volontaire de la ville. Le vieillissement de la population fait craindre les campagnes. Je pars un peu tard, car j’ai bien traîné à Hillsboro. Le soleil est dur lorsque je m’enfonce vers Emory Pass, avant d’y camper en contrebas. Les paysages sont magnifiques et d’une étonnante diversité ! La terre rouge enferme de grosses pierres rondes, et les routes suivent parfois des canyons aux flancs abrupts couverts de pins. Le soleil m’a étourdi, et je campe tôt, seule dans le calme au bord d’une rivière sèche.
Dans la vallée du Rio Grande, des travailleurs immigrés entretenaient les champs qui sentaient l’oignon et le piment. J’ai vu un élevage de veaux : chaque animal était dans une cage individuelle assez grande pour y mettre une niche et un petit espace extérieur, aussi long que l’animal, sur de la terre battue avec une buvette. Les cages étaient à dessein trop étroites pour qu’ils y puissent faire un demi-tour. Ils pouvaient seulement reculer ou avancer afin de s'asseoir, soit dans leur niche, soit à l'extérieur. Il y avait une centaine de cages, toutes espacées par deux mètres de terre battue. Les veaux ainsi traités ont la viande tendre, car jamais ils n’exercent leurs muscles avant d’être menés à l’abattoir. J’ai aussi vu un élevage de coqs. Des bidons coupés en deux avec une ouverture leur faisaient une niche individuelle, et les coqs y étaient attachés à la patte, d’une longe juste assez longue pour qu’ils puissent se poster sur le sommet de leur niche ou dedans.
16 avril
Je continue la descente d’Emory Pass jusqu’à San Lorenzo : c’est décidé, je fais un bout de la Great Divide Mountain Bike Route, la même route que la Tour Divide, qui me fera bifurquer vers le nord pour deux jours. J’ai un peu de peur et d’excitation à l’idée d’emprunter cette route rêvée depuis si longtemps. La sécheresse de la montagne m’inquiète quant au ravitaillement en eau, et je demande à la femme du magasin général des informations.
– Is there going to be water up in the mountain ?
– No there won’t, it’s all good !
– What do you mean « it’s all good » ?
– « Good » means « O.K. ».
Il s’ensuit un dialogue de sourds, où elle m’assure avec enthousiasme que la montagne sera sèche, que les rivières et les ruisseaux seront tous bien vides. Mais y trouverais-je de l’eau, je lui demande ? À mes questions répétées, elle semble croire que je ne comprends pas le mot « good » et m’en donne des synonymes. Des travailleurs forestiers entrent et je leur demande : oui, il a bien neigé l’hiver dernier, donc les rivières auront de l’eau. Je prends deux jours de nourriture et je pars. Je comprendrais le lendemain pourquoi l’absence d’eau était « all good ». Le magasin général sert aussi de petit café au village. Je n’ai pas de réseau depuis la veille, et du téléphone d’un homme, j’envoie un message à mes parents pour leur dire que je passe quelques jours dans la montagne et que tout va bien.
La journée est merveilleuse, les conditions sont parfaites. Les pistes m'emmènent dans le massif isolé. Je vis une des plus belles après-midi de ma vie, où je retrouve l’essoufflement du sublime que je recherche tant. J’ai vu trois petits serpents (et accidentellement roulé sur l’un d’entre eux), des dindons, des pécaris et des biches. Il y a des défilés de gros cailloux et des ruisseaux blancs. De larges ponderosas poussent dans des vaux dégagés d’herbes hautes et claires. Je m’arrête à une rivière pour midi et m’étire. Il y a un grand soleil. Je passe dans un large canyon rouge plein d’herbes hautes avec des vaches. J’admire un lac où elles paissent. Dans le calme, je sors mon téléphone pour noter cette résolution, avant qu’elle ne fuit avec le moment : « Je veux vivre dans un lieu comme ça. Au diable Paris, au diable les bureaux. » Ainsi était mon âme devant tant de beauté. Les canyons me jettent dans de larges prairies aux herbes courtes de la couleur du Wyoming. Quelle surprise !
Je n’y trouve pas d’eau. Le vent se lève contre moi. Je croise des cyclistes qui m’indiquent un réservoir que j’atteins au coucher du soleil, mais il est trop sale d’ordures de vaches pour que j’y risque de filtrer de l’eau. Je vois au crépuscule deux biches dans la plaine. Il devrait y avoir de l’eau quelque part. Je pourrais continuer, tant je me sens de l’énergie, mais je m’arrête dans les dernières lueurs. Je campe sous une lune quasi pleine, sur le flanc d’un petit mamelon, si commun au Nouveau-Mexique. J’ai fait 170 km avec 2500m de dénivelé dans la journée. Je prévois de continuer au nord jusqu’à Pie Town, à la réputation magique, avant de reprendre la route vers l’ouest. Le ciel se couvre, et à 23 h, un grand orage éclate.
17 avril
Je dors peu la nuit, car l’orage est bruyant et les lumières des éclairs sans cesse me réveillent. Ma tente tient bien la pluie battante et je lui dis des mots doux en demi-sommeil. Au matin, le bruit de la pluie sur la toile a changé : c’est à présent de la neige fondue qui tombe. Elle tiendra en haut des petits monts et sur les faces sud des collines. Je me lève et pars entre deux averses. Ce sera la pire journée de tous mes voyages jusqu’ici. Les routes de terre rouge sont en fait de l’argile : une fois mouillées, elle colle aux pneus et s’y accumule en briques formidables. La boue y forme alors de gros boudins qui se bloquent dans ma fourche et détruisent ma transmission. Je tente d’aller dans les hautes herbes, espérant brosser la boue de mes pneus ainsi, mais elle se mélange aux tiges et aux cailloux pour former de l’adobe, le matériau de construction le plus courant d’ici, encore pire à dépêtrer. Je passe la matinée à tenter d’avancer dans ce bourbier. Parfois, de la roche est à nu sous la route et je peux à nouveau avancer, et parfois l’argile est assez mélangée à des graviers pour être un peu plus stable.
Le vent s’est levé contre moi. Il doit aller à 30 km/h, ralentissant ma progression (mais peut-être sèche-t-il un peu la couche supérieure de l’argile). Je hurle de rage dans la plaine, à bout. Je suis dans une large zone de prairie entre deux fils de collines. Le vent qui agresse mes oreilles me fait souffrir. Des averses me frappent le visage tandis que je pousse ou pédale tant bien que mal. Je m’abrite dans une maison abandonnée qui sert d’abri pour les vaches. Le sol est couvert de bouses, et je profite de ce précieux instant de silence dans la puanteur. Je reste debout en mangeant un peu, mais je n’ai même pas faim. Je me réenfonce dans la montagne, les averses se muent parfois en grêle ou en neige fondue. Le vent y est parfois moins fort. Je suis à cours d’eau. Lorsque je trouve enfin une source et que je m’y arrête, j’y trouve deux carcasses d’animaux là où l’eau sort de la montagne. C’est seulement l’après-midi que je trouve de l’eau à nouveau et je la filtre tandis qu’il se met à neiger. Je n’ai croisé personne sur cette route maudite depuis les cyclistes de la veille, pas même un véhicule. Je pousse mon vélo dans l’argile toute l’après-midi. La boue a emplâtré ma transmission et elle ne fonctionne plus. La nettoyer en en ôtant la boue à pleines poignées ne sert à rien, elle se rembourbe aussitôt.
À 16 h, je suis sur une route d’argile profonde, il n’y a plus de dalle de roche en-dessous. Je tente de pousser, de porter, de pousser dans l’herbe, espérant pouvoir faire les 30 km qui me restent jusqu’à Pie Town ainsi. Mes chaussures accumulent également l’argile et je porte des sabots de plusieurs kilos de boue que je dois retirer par poignées tous les quelques mètres. En poussant mon vélo dans l’herbe, près de barbelés, je me blesse le côté de la fesse. Mon short a un large trou. À 17 H 30, je suis épuisée. Il pleut à nouveau. Je suis confuse de fatigue. J’ai dû réussir à faire une cinquantaine de kilomètres, pas plus. Je décide de planter ma tente dans un pâturage ouvert, entre des arbres recroquevillés et des bouses momifiées. J’espère que l’argile séchera pendant la nuit, au moins assez pour me permettre d’atteindre Pie Town, d’où je pourrais retrouver une route de bitume et repartir vers l’ouest. Il ne me reste qu’un fond de beurre de cacahuète à manger, après, je n’ai plus rien. Je me suis rationnée pendant la journée. Je n’ai plus d’eau non plus. Mes mains, mon visage et mes jambes sont couverts d’un masque rouge d’argile, car toute la journée j’ai retiré par poignées des briques de boue de mon vélo, puis m’en suis frotté le visage, de désespoir. Je ne prends pas la peine de me nettoyer avant de me mettre dans mon sac de couchage et dors comme ça dix heures d’un sommeil profond, jusqu’à 5 h. Je suis si fatiguée que je ne sens ni la faim, ni le froid. J’entends des coyotes en sombrant.
18 avril
Je me lève à 5 h et je range tout très vite. Les restes de boue de mon vélo ont séché (la pluie ne les a pas nettoyés) et ma transmission est hors-service. La chaîne est devenue si solide que les maillons ne s’articulent plus. Le ciel est clair, je vois les étoiles dans les premières lueurs. Les mamelons sont couverts d’un peu de neige. Je retourne sur la route. Elle n’a pas séché, mais gelé, et je peux à peu près marcher dessus en poussant mon vélo. Je me mets en route. Je vois dans la terre des traces de pas, trois personnes, dont une plus récente, avec des anciennes traces de sabots de vache. Ces empreintes m'intriguent.
Après deux ou trois kilomètres, je vois un panneau sur la barrière d’un ranch : « Davila Ranch – CDT Trail Angel ». Mais bien sûr ! Je suis sur la Continental Divide Trail ! Ceci est un sanctuaire pour randonneurs ! J’y porte mon vélo. Je n’en crois pas mes yeux. C’est un large abri ouvert en deux parties, avec plusieurs frigos pleins, des machines à laver, une douche, une petite cuisine, de l’eau, de la nourriture, et même un modem ! Je m'assois sur un rondin, regardant tous les objets de confort qui m’entourent, et je pleure un peu. Je sens alors que depuis 24 heures mon esprit, guidé par l’obstination d’avancer dans les conditions terribles, refrena toute peur, tristesse, fatigue ou faim. À présent, il se relâche. Je décompresse en regardant les messages de ma famille des deux derniers jours, surtout les photos du chat qu’ils m’ont envoyées. Je me calme. Je ne me sens plus seule. Je lève la tête et vois Ryan. C’est un randonneur de la CDT (northbound), qui a campé derrière l’abri et s’apprêtait à partir. Nous discutons. Mon épreuve de la veille semble alors lointaine. J’ai à nouveau très faim, après avoir si peu mangé hier. Le frigo est remarquablement fourni. Je ne rêve que de pâtes au fromage. Hier, Ryan était derrière moi et il a vu mes traces de pas et de roues zigzaguant misérablement dans la boue. Il va à Pie Town aujourd’hui. Il marche bien mieux que moi dans la boue avec son sac ultralight et ses bâtons de trail. Après son départ, je prends le temps de nettoyer ma transmission avec un tuyau d’arrosage et de la regraisser. J’essaie d’en économiser l’eau de la citerne au maximum, utilisant juste assez pour remettre en état de marche mon vélo. J’espère que le soleil d’aujourd’hui séchera la boue. À 9 h, je repars, pleine d’énergie.
À peine ai-je rejoint la route que mes pneus s’embourbent, aussi bellement que la veille. Je ne peux pas pousser. Je prends ma polaire et la noue en huit pour former un joug protecteur sur mes épaules, puis y charge mon vélo et me mets en marche. Ryan m’avait dit que Pie Town était à 5 h de marche. En portant un vélo chargé, ce sera plus. J'espère n’en avoir à faire que quelques-unes et qu’à l’approche de la ville, la route se muera en une piste recouverte de gravier. Après chaque butte, car la route va droit dans des vallons, je prie pour voir un changement dans la nature du sol. Je marche une ou deux heures, très lentement, portant à mes chaussures des bottes de boue qui s’y accumulent. Mes mollets fatiguent vite du poids. Un pick-up apparaît au sommet d’une montée. Il avance lentement vers moi, avec ses quatre roues motrices activées, moitié glissant, moitié charriant la boue. Je dépose mon vélo et le laisse s’approcher. Il baisse sa vitre et me crie « Are you having fun ? », et je réponds d’une voix suppliante « Noooooooooo ». Je le prie de m’emmener à Pie Town, qui n’est plus qu’à une quinzaine de kilomètres. C’est un vieil homme qui allait voir ses bêtes, faute de mieux à faire, et accepte volontiers la course. Nous chargeons mon vélo à l’arrière du pick-up et je monte dans la cabine aux côtés de son chien qui me lèche la boue et le sel des jambes. L’homme a une .22 calée entre nos deux sièges, « pour tirer les coyotes », me dit-il lorsque je lui demande. Je lui promets de lui payer une bière à Pie Town pour m’avoir sortie du pétrin, mais il refuse, et sort de sa boîte à gants une canette de bière qu’il s’ouvre, et m’invite à me servir. Il est dix heures du matin. Je lui pose des questions sur le pays et ses habitudes. Nous avançons lentement dans la boue, et il faudra une heure pour atteindre Pie Town. Nous dépassons Ryan qui marche en levant haut les jambes dans la boue et le hélons. Il préfère continuer à pied. L’homme me dépose devant la Toaster House.
La maison légendaire dont Dylan m’avait parlé, ouverte à tous les voyageurs, est en effet bien nommée : des grille-pains sont posés sur chaque poteau de la barrière qui enceint le jardin. Sous le porche, il y a des dizaines de colis déposés, que les randonneurs s’adressent à eux-mêmes pour se ravitailler lors de leur traversée. Je rencontre deux randonneurs, ceux qui avaient laissé leurs traces dans la boue. L’un est en kilt (pour l’aération, me dit-il en fléchissant les jambes et en secouant les pans de ses deux mains). Il est plein d'énergie, tandis que l’autre est plus taciturne. Comme sur tous les sentiers de randonnée de très longue distance, on se retrouve à randonner avec les inconnus que l’on croise, pour le meilleur et pour le pire, et celui qui est taciturne semble un peu fatigué de son nouveau camarade. Il faut alors prendre un jour de repos pour se séparer du compagnon, ou alors, au contraire, accélérer et prendre des jours d’avance. Dans la Toaster House, il y a des lits, une cuisine, une salle de bain, un stand à vélo, un jardin… et des placards pourvus de tous les objets que les randonneurs y ont abandonnés : des chaussures, des manteaux, du surplus de nourriture, des réserves de gaz, des médicaments et divers objets de pharmacies plus ou moins spécifiques. Il n’y a pas de magasins dans Pie Town, seulement trois restaurants, tous spécialisés dans les tartes, et trois églises.
Je me lave, moi, mon vélo et mes vêtements, tous plein de boue. Ryan arrive, et nous allons ensemble au restaurant. J’ai emprunté des vêtements à la maison tandis que les miens sèchent. Ryan mange trois plats et deux énormes parts de tartes. Je suis subjuguée. Jamais je n’ai vu quelqu’un manger autant. Ryan est maigre et la nourriture dans son estomac lui fait un « food baby ». Je passe l’après-midi à lire et à me reposer. Je passe le balai dans la maison, afin de contribuer à la tenue du havre. Les deux randonneurs sont repartis.
L’après-midi, un homme vient en quad à la Toaster House. Il se prénomme Jeremy et nous apporte du ragoût dans un tupperware et de la moonshine qu’il fait lui-même. Il nous montre comment en estimer la pureté : il secoue la bouteille en verre, puis la tient à l’horizontale à la lumière du plafonnier et observe les bulles. Il en déduit à l'œil le degré d’alcool. C’est un hillbilly du Kentucky, et son accent est si fort que Ryan (de l’Utah) le comprend à peine. Curieusement, j’ai bien plus de facilité. Jeremy m’annonce que la cathédrale de Notre-Dame a brûlé deux jours auparavant. Il en est ému.
– It ain't about the Catholic Church and its bullshit, it’s about our heritage, not only France, but the whole Western world.
Il a tant le sentiment d’avoir un héritage culturel commun à l’échelle de l’Occident, que la perte d’un de ses symboles les plus forts le touche. Même ici, à Pie Town, au Nouveau-Mexique, son identité personnelle est reliée à celle d’une lignée culturelle occidentale, européenne. Il parle de la moonshine que son père, son grand-père et son père avant lui faisaient ; elle fait partie de son héritage et de son identité personnelle. Cette moonshine qu’il nous offre est une partie de lui. Il nous invite à sa maison le soir, car des amis y viennent jouer de la musique.
– I ain't gonna lie to ya, we smoke weed big time ! I got my card for medicinal marijuana after I got shot three times in Irak. And I don’t hold a grudge against the French who didn’t come help us, mind that ! But you best believe, I got more of ‘em than they got me !
Il laisse planer un silence d’une seconde en nous regardant dans les yeux et en acquiesçant à sa propre phrase. Je le regarde, et il me semble qu’une grande conversation se passe dans l’instant. Jeremy nous met au défi d'émettre un jugement moral sur la guerre et ses soldats, et il ne trouve chez moi en réponse qu’un vide de compréhension, et il l’accepte. Nous nous tenons en respect. Je repense à une des fois où A me contait l’une de ces choses qu’il avait de lourd sur le cœur, lorsqu’il a vu un soldat américain abattre d’une balle dans la tête à bout portant un ennemi blessé sur une civière, et qu’il s’est tu, n’a pas dénoncé, car on l’aurait probablement abattu lui aussi en combat s’il avait envoyé un homme en prison militaire pour avoir tué un adversaire. Et de ça, je comprends qu’il existe un espace dans la guerre où l’ordre moral est sujet à tant de heurts qu’on ne peut reprocher à un homme de n’avoir agi que comme il l’a pu, et non comme il l’aurait voulu, et je ne leur en tiendrais peu rigueur. Ryan, lui, le juge plus durement après que Jeremy soit reparti sur son quad. Son antimilitarisme est exprimé par un dédain des représentants de la guerre. Je comprends cela aussi. Le soir, nous tentons de suivre de mémoire les instructions que Jeremy nous a rapidement énoncées (une suite de tournants et de carrefours, avec une église quelque part), mais nous ne parvenons pas à trouver sa maison. Nous buvons la moonshine sur le porche de la Toaster House. C’est l’alcool le plus doux que je n’ai jamais bu. Je dors confortablement dans un lit chaud sous le poids écrasant des nombreuses couvertures.
19 avril
Nous allons manger une tarte pour le petit-déjeuner avec Ryan avant que je me mette en route vers l’ouest. Il a encore bien du chemin à faire au nord avant la fin de son voyage. Je repars sur les routes bitumées et je file à bon train vers l’ouest toute la matinée. Ma respiration est synchronisée sur ma cadence et j’avance rapidement. Je sors du pays de petits monticules aux buissons épars sans m’arrêter. Mon ventre est lourd de la tarte sucrée jusqu’à l’Arizona. J’atteins des canyons secs et roses, avec des broussailles blanchies. J’ai un mauvais pressentiment. C’est un de ces rares moments où l’on ressent inexplicablement l’arrivée d’un grand malheur, surnaturel, imminent. Puis rien n’arrive. J’arrive à Spingerville, me ravitaille et monte dans la montagne avec la chaleur de l’après-midi. Les forêts sont éclairées, de pins et d’herbes sèches, avec de gros éboulis clairs et ronds. Les routes sont étroites, et les automobilistes me frôlent. J’entre l’après-midi en territoire apache. J’ai changé de zone horaire, et le coucher de soleil me surprend en avance à Pinetop. Au sommet des montagnes dans l’après-midi, vers 2800m, de grands bancs de neige bordaient les routes, et il y avait de petits marécages de neige fondue. Le paysage de plateaux est alpin, légèrement collineux et couvert de fleurs lorsqu’il y a de grandes ouvertures dans le paysage.
20 avril
Je dois d’abord parcourir quelques dizaines de kilomètres sur une route très fréquentée. Mon mauvais pressentiment de la veille se confirme peut-être dans cela : les conducteurs me frôlent, aucun ne prend la peine de ralentir ou de me donner de la place pour me dépasser. Cette manière de conduire sera présente dans tout l’Arizona, comme un acte d’irrespect pour la vie humaine. J’atteins enfin des routes de terre, qui bordent l’immense canyon de Mogollon Rim. Je suis sur la gouttière de ce monde, longeant le bord du canyon toute l’après-midi. Je vois la canopée jusqu’à l’infini en contrebas, sans la moindre trace humaine. Il n’y a ni ville ni infrastructures. C’est magnifique, et j’en oublie les désagréments du matin. J’entre dans la forêt de Coconino par des routes fermées aux véhicules. Il reste sur les pistes des barrages de neige et d’arbres qui ont chus sous le poids des neiges. Le vent pousse de côté. Je suis rattrapée dans une montée par un véhicule, une sedan qui avance très lentement entre les trous d’eaux et les arbres tombés. Je me demande comment il est parvenu jusqu’à moi. Le conducteur ouvre sa vitre, il semblerait que ce soit une famille, et il me demande avec un accent indien où se trouve « le lac ». Quel lac ? Comment a-t-il passé tous les arbres abattus ? Plus loin, je le vois faire demi-tour, là où la route le permet sur un élargissement au bord d’un vide.
Des formes géologiques qui me sont inconnues ornent les bordures des falaises que je parcours, et que je découvre lorsque j’ai fait une partie de la courbe et vois à ma gauche ce que j’ai parcouru. Une nouvelle chaîne de montagnes apparaît en bleu au loin à droite. Je ne ressens pas la fatigue, m’étire lors d’une pause dans les sapins, comme j’en ai pris l’habitude. J’ai un genre de point de côté qui ne part pas depuis plusieurs jours. Je croise le tracé de l’Arizona Trail et campe sur son long près de la hutte de General Springs. J’ai le soir un fort déjà-vu d’un rêve ancien. Le soleil se lève à 5 h 30 ces jours-ci. Il ne fait plus trop froid la nuit. J’atteins la fin de mon premier carnet de voyage.
21 avril
Je me réveille sans rosée, remonte sur la route et repars. Je crois que je descends un peu, car il y a de moins en moins de nuages. J’ai continué La Recherche du temps perdu, et j’en suis au point où le narrateur touche à la fin de sa recherche : l’intemporel, commun à tous ces instants de félicité, qui relie passé, présent et futur, au-delà de la mort, dans les récollections. Je quitte les Highlands et fais une petite journée vers Flagstaff par le lac Mary. J’arrive dans des lieux où la topographie m’est par instants familière. Il y a beaucoup de vent, 30 ou 40 km/h. Il est parfois de face, parfois de dos, dans des élans qui suivent les petits monts ronds. Les prairies collineuses sont creusées de petits lacs de neige fondue. Depuis la veille, je roule en rythme, soutenue par ma cadence et ma respiration qui vont ensemble. Il m’a fallu un mois pour me familiariser avec les rapports de vitesse de mon vélo, car chaque fois les sauts entre les vitesses manquaient le point où mes jambes auraient vraiment trouvé leur compte.
À Flagstaff, je vais droit au magasin de vélo pour mon frein avant dont la mollesse s’est amplifiée inexplicablement à nouveau. Ce vélo semble plein de problèmes. Le jeu de direction a également repris du jeu depuis que je l’ai resserré. Peut-être que je ne sais pas resserrer correctement le système d’insert dans la fourche en carbone ? En regardant les gens du magasin de vélo faire, je vois que leurs gestes sont pourtant les miens. Ils sont peu sympathiques. J’essaie de leur demander si les routes ici sont en argile, semblables à celles qui m’ont enlisé si douloureusement, et si je puis m’y aventurer alors que des averses se préparent au nord. Leurs réponses sont floues, comme s’ils n’avaient jamais passé la barrière du magasin pour aller rouler au nord de la ville, mais refuseraient de me le dire, et me disant tantôt oui, tantôt non. Je prends un motel en ville après avoir bu une bière en terrasse. Je suis sur les nerfs d'être ainsi coincée sur des routes dangereuses sur un vélo défectueux, sans savoir où aller le lendemain. Je renonce à tenter d’aller, comme je l’espérais, faire une boucle par les volcans au nord, craignant les averses et les routes d’argile (qui peut-être n’existent pas, selon les dires du mécano du magasin).
Je regarde à la télé du motel le dernier Harry Potter, qui ne me laissera aucun souvenir. Flagstaff est dominée par une très grande montagne enneigée. Le centre historique est beau. Dans le campus de l’université, des petits robots automatisés sur roues se chargent de commissions entre les bâtiments. La route 66 passe par la ville, et je vois un tourisme comme je n’avais encore jamais vu aux États-Unis. Voilà des mois que je n’avais pas vu d’étrangers, et ici, en ville, je croise des groupes d’allemands qui prennent en photo les monuments commémoratifs et des français en camping-car de location. Les villes tout le long de la route 66 ont gardé, dans un souci touristique, les abords de la voie dans un jus d’Americana des années 60, avec des pointes de Wild West ici et là. C’est comme un très long Disneyland dont on ne sort pas, pourvu qu’on reste sur la route 66, comme une Amérique de carte-postale très allongée.
22 avril
Je prends un énorme petit-déjeuner, la gloire du motel. Le réfectoire est maquillé en diner, j’y mange des tater-tots au ketchup avec beaucoup d’omelette (faite de vrais œufs) et des muffins. Je pars tard, toujours indécise quant à ma destination. Je prends des chemins de terre du piémont de la montagne enneigée pour sortir de la ville. Des cervidés blonds courent au-devant de moi. Je me perds et je dois pousser mon vélo dans des trouées de lignes électriques et passer en portage leurs remblais de stabilisation faits de grosses pierres. Je suis l’ancienne Route 66, qui court en parallèle de la moderne, jusqu’à Williams. La ville est très touristique. J’entends dans les rues beaucoup de langues européennes. C’est la première fois que je vois des touristes dans une si petite ville (3000 habitants). Tout le jour, je descends progressivement en élévation par faux plats vers les plaines désertiques de l’Ouest. En sortant de Williams, j’emprunte la route du Chino Grinder (récupérée la veille sur internet) pour rejoindre la Chino Valley vers le sud. Enfin, me voilà sur une superbe route de gros gravier gris. Je quitte les pinèdes pour un paysage de buissons parsemés. Les rivières sèches ont creusé des cours profonds et poli les roches avant de s’éteindre en petites fosses. Des poussières se soulèvent sur mon passage. La montagne est comme peinte en rouge par des coups fermes et sûrs. Une voie de train désaffectée menait jadis à des mines dispersées dans la montagne. Des nuages s’installent, et je vois les averses loin de moi toucher les vallées avoisinantes. Mes mésaventures du Nouveau-Mexique sont encore bien fraîches dans ma mémoire : je trace les 80 kilomètres de pistes en moins de 4 h, sans m’arrêter, de peur que l’eau transforme les routes en cauchemars à nouveau. Un caillou projeté par ma roue avant perça la bouteille d’eau que j’avais placée sous mon cadre. J’atteins une vallée immense, vide de ville, et je ne vois pas où ma route va en s’y engageant. L’aridité m’inquiète un peu, il fait chaud. J’atteins des prairies sèches et le vent forçit contre moi.
Depuis quelques jours, la poussière des routes de terre me fait tousser, et j’ai un peu de sang dans mon mucus nasal. J’atteins à nouveau une ville qui me rebalance sur une route étroite et dangereuse. J’arrive une heure après le coucher du soleil à un départ de randonnée de la Prescott National Forest, en banlieue de Prescott. Le règlement local n’est pas le même que dans les autres forêts nationales : l’accès est interdit de nuit, le bivouac également. J’y pousse tout de même mon vélo sur un sentier étroit, vers une hauteur, pour camper. Je ne distingue pas grand-chose dans le noir. La forêt est un ensemble d’escarpements couverts d’herbe fine et drue, surmontés de rocs et d’éboulis où des arbres buissonnants peinent à pousser, tordus comme en souffrance. Beaucoup portent des épines sur leurs feuilles ou leurs branches. Des cactus et des plantes piquantes rampent au sol. Je peine à trouver un endroit dissimulé et assez peu pierreux afin de planter ma tente, après avoir ôté ou couché les petits cactus. Je m’en plante une grande épine dans la main. Je finis mes provisions et me hâte de dormir.
23 avril
La lune est encore haute dans le ciel au matin. La montagne ressemble à un agglomérat de cailloux englué de terre rouge. Alors que je finis de plier ma tente, une femme et son chien passent à côté de moi. Moi qui me croyais isolée sur une hauteur dure à atteindre, entre les cactus et les éboulis, j’avais en fait rejoint un petit sentier caché dans les broussailles sur les hauteurs. Je l’emprunte pour redescendre. C’est bien plus simple que l'ascension que j’avais faite la veille à crapahuter parmi les cactus. Le problème de mon frein avant a empiré. Le piston ne revient plus correctement et je dois pomper pour qu’il ne freine pas tout à fait lorsque je roule. Je dois m’arrêter à Prescott pour le faire inspecter. Je vais au magasin où j’étais allé il y a deux ans, dans la confusion de mon intoxication alimentaire. Il me faudra attendre deux jours. Je médite à mes maigres options pour rejoindre la Californie en évitant la chaleur du Mojave ainsi que les routes fort dangereuses de l’Arizona. Une vague de chaleur va prendre le désert, les températures descendront à peine en dessous de 40, une très mauvaise idée pour faire du vélo sur des routes fort empruntées.
Mes chaussures m'empêchent de marcher longtemps, et j’arpente seulement le centre-ville. Je me souviens de la place, de l'hôtel de ville, et je me souviens comment les lumières de Noël éclairaient un grand sapin là-devant. Je me souviens également de la douleur et du mauvais moment que cela a été. Je bois une stout au bar et je vais loger au motel de la dernière fois. La femme qui tient le motel me reconnait. Soit sa mémoire est bonne, soit je suis mémorable. C’est surprenant et un peu effrayant à la fois, car la croyance en l'anonymat de mon existence est en général une certitude qui me rassure. Je crois que j’ai la même chambre que la dernière fois, ou alors celle d’à côté. Des souvenirs fiévreux me reviennent, de m’être effondré sur le lit et d’y avoir dormi longtemps, de tenter de me forcer à boire de l’eau et à manger un peu, de sentir mon cœur dans mes tempes, en plus de la sensation de verre pilé dans mes intestins. L’après-midi, une femme me demande si je suis de la ville, car mon visage lui est familier. Je mange et bois, ne trouvant de solution pour cette traversée du désert chaud avec un fort vent de face.
24 avril
Je passe au magasin de vélos pour voir l’avancée de la réparation. Il y a une course de prévue en ville ce week-end, le magasin est très occupé de travaux de dernière minute. Je discute avec le mécano. Les freins hydrauliques Sram ont mauvaise réputation parmi les mécanos américains. Ce magasin ne vend plus de vélos qui en sont équipés, pour ne pas avoir à régler ce genre de problèmes. Il a démonté toutes les pièces de l’étrier, les a nettoyées, puis l’a repurgé. Depuis quelques jours, je pense à la Tour Divide. Mon désir de concourir s’affirme peu à peu. Si j’y vais, j’irai sur le Fargo.
Je discute dans le parc avec un homme étrange qui promène un caniche.
25 avril
Je quitte le motel, entre chez Hertz, et une demi-heure plus tard, je suis au volant d’une voiture avec mon vélo à l’arrière. L’homme du comptoir avait des manières de John Malkovich. Je n’ai pas conduit depuis deux ans et je n’ai jamais loué de voiture de ma vie. C’est stupéfiant de pouvoir me retrouver aussi simplement au volant d’un véhicule. Depuis le début de mon voyage, j’ai eu plusieurs fois l’impression d’évoluer comme dans un RPG, où à chaque ville, chaque nouveau monde, des personnages et des lieux s’offrent à l’exploration et à de nouvelles quêtes. De m'être arrêté aux fiançailles à Turkey après les crevaisons m’a fait rencontrer Danny. En acceptant d’aller loger chez lui, j’ai rencontré son voisin qui m’envoya au Stellar Café dans la prochaine ville. Parler au comptoir me fit rencontrer Megan et Dan, que je retrouvais aux White Sands. Il y a aussi eu mon bref moment de vendeuse de cycles à Lubbock, qui me procura l’adresse d’un logement à Ruidoso. Et toutes les fois où entrer dans des magasins et parler au comptoir me procura des informations pour continuer mon voyage. Voici que j’entre chez un marchand et repars au volant d’un véhicule, mon Epona pour 24 heures, qui me fait sauter un niveau. La voiture est en boite automatique, et les routes d’Amérique sont simples et larges. La conduite est heureusement facile pour mes sens rouillés.
J’ai loué la voiture pour 24 heures, le temps minimum, juste de quoi traverser le désert tout droit vers les premières vallées de Californie. Une partie de moi a le sentiment d’être une tricheuse, de transgresser les règles invisibles du voyage à vélo. Une autre est bien heureuse d’échanger quatre jours de routes dangereuses sous un soleil étouffant contre un détour par les collines de Californie. Puis, voilà une brève expérience hautement cinématographique. Je regrette tout de même, sur certaines routes que j'emprunte, de ne pas être à vélo. Malgré la climatisation, je sue à grosses gouttes dans l’habitacle. Je m’arrête à Kingman, et le musée n’a d’intérêt que la vieille femme manchot qui tient la caisse. Je mange un gigantesque burrito noyé de sauce dans une cantine mexicaine. J’y observe les gens. Il n’y a plus de paysans et d’éleveurs comme auparavant, mais des familles en vacances. Il y a un couple de mon âge, semblable à des personnages d’Araki ou de Linklater. Je les regarde. J’aime leur manière d'interagir. Dans une autre vie, ils auraient pu m’être chers. Je suis la Highway 40, le tracé de l’ancienne route 66, et les bâtiments des rues principales sont peints de couleurs pastel de l’Amérique des années 60. Toutes les villes-étapes continuent de se ressembler.
Se déplacer en voiture dans l’immensité du désert et des montagnes arides est étrange, c’est comme un rêve qui défile, sur-réel, autour de l’habitacle, dont la rigueur, la majesté et la dureté sont anesthésiées comme par une drogue. Le mot « sur-réel » me surgit, sorti des pages d’un livre d’essais dont je ne connais plus le nom ni le lieu où je le feuilletais, qui parlait de ce mot. « Surreal », comme un irréel qui ne serait pas l'absence de réel, mais au contraire sa présence si intense qu’elle en perd son sens à nos yeux : sur-réel. Cette étrange sensation me fascinera les premières heures, car je n’ai jamais fait de longs trajets en voiture, surtout dans l’immensité. Puis je commence à m’ennuyer. J’écoute de la musique à fond, en réalisant ainsi un rêve d’adolescence un peu niais : être au volant avec le volume à fond dans le désert californien en chemise hawaïenne, un granité dans la main droite et du bordel à l’arrière. Je pense à un mauvais roman de jeunesse dont je n’avais jamais suspecté la part de réalité inachevée qu’il portait en lui. Qu’est-ce que j’ai l’air cool.
La nuit, je suis sur une route de terre en tôle ondulée. Les phares éclairent les volutes fantomatiques que je soulève. Je ne vois pas au-delà. Je prends des tournants sans voir où je vais et j’ai des frissons d’excitation à avancer à l’aveugle. Je plante ma tente dans le désert sans voir où je suis. Il fait chaud. Je bois des bières allongée sur la terre sèche et sableuse à côté de ma tente en regardant les étoiles. Je me souviens des nuits d’été où l’on peut voir la voie lactée dans les champs. Aucun insecte ne me dérange. Une fois saoule, je vais me coucher.
26 avril
Aux premières lueurs, je découvre le paysage. Je suis dans un canyon sec. J’atteins rapidement la vallée de Bakersfield, où je dépose la voiture chez Hertz et offre aux garagistes le reste de mon pack de bières. Je repars pour les collines. Je suis maintenant en Californie. J’ai quitté les hauts plateaux : Bakersfield est quasiment au niveau de la mer, dans une longue vallée réputée pour sa chaleur, qui se poursuit au sud jusqu’aux banlieues de Los Angeles. Je repars à l’est pour monter dans la Sierra Nevada, la chaîne de montagne du Pacifique. Il fait déjà très chaud. Je m’arrête à 13 h sous un arbre pour laisser passer les chaleurs de la journée. J’ai retrouvé des nuées d’insectes avec la plaine. Les collines ressemblent dans leurs couleurs à mes souvenirs d’Oregon, mais plus sèches. Le jaune n’est pas du blé, mais des graminés sauvages qui, en cette époque, devraient probablement être vertes. Au fur et à mesure que je monte, je vois de nouveaux arbres qui me sont inconnus, des genres de chênes. J’écris ces lignes sous l’un d’entre eux, dans des éboulis de granits qui me tiennent au frais. De l’autre côté de la route, il y a des vaches dans un pré.
Je ferai plusieurs pauses dans la chaleur épuisante de l'après-midi avant de faire le col final, qui m'emmènera à 1900m. Je pénètre au-dessus des collines d'herbes sèches dans un défilé rocailleux. Je remonte progressivement une rivière en zigzaguant très au-dessus du lit dans les pattes des montages. Les herbes deviennent plus grasses, les arbres plus denses, et la Californie commence à ressembler au pays de cocagne des anciens tableaux anglais. Cette vallée, je la reverrai parfois en rêve pendant de nombreuses années. À la sortie d’une ferme, un petit chien qui ressemble à un bâtard de coyote et d’Akita se met à me suivre et grimpe dans la montagne avec moi. Il disparaît parfois dans les buissons à la poursuite de lapins ou d'écureuils, avant de revenir près de moi. Il me suit pendant une trentaine de minutes, jusqu’au tournant qui me fait entrer dans la Sequoia National Forest. Je remarque par leurs énormes cônes aux drôles de formes quelques séquoias, encore petits et esseulés. Je ne finis pas l’ascension du col. La fatigue me prend brutalement, et je vais m'asseoir sur le rocher d’un promontoire. La vue y est si belle que j’y reste pour camper. Entre les arbres apparaissent des dômes de granit d’un seul tenant qui surplombent une vallée couverte d’une canopée dense de verts.
27 avril
Je me réveille au lever du soleil, ayant bavé sur mon matelas. J’entends des chiens dans le défilé, et tandis que je m'apprête à plier ma tente, un pick-up avec deux chiens de chasse passe non loin de moi. Les chiens aboient en ma direction, mais le conducteur ne me voit pas. Je finis la montée avec aisance dans la fraîcheur de la matinée. Puis la descente est infinie vers le lac Isabella, aux vues de paradis. Les gens sont aimables au supermarché, et l’air est doux. La Californie est bien collineuse ici, et les montées fort pentues. Je remonte un torrent, une rivière qui coule fort, avec dans les éboulis qui la bordent des kayakistes qui se préparent. Il fait chaud, et plus je monte, plus les arbres se multiplient et remplacent peu à peu les champs de granit aux herbes sèches. Il y a plein de petits ruisseaux de fonte de neige. Je m’arrête longuement à midi, près de la rivière, dans un champ où le sol a été piétiné par des bêtes. Je repars après avoir trempé mon t-shirt dans le cours afin de me garder au frais durant l’ascension. Quelle belle journée.
J’atteins à nouveau des séquoias, à la limite des neiges. L’air est plus frais, à présent rafraîchi par des murs de neige qui bordent la route, et je sens à vélo que la neige irradie du froid. Certains panneaux routiers sont sous la neige à Ponderosa (à 2200m). Les fontes font de belles étendues d’eau. Les montagnes sont chapeautées de blocs de granit chauves. La descente est si longue que j’ai du mal à croire avoir tant grimpé. Je recroise tous les types de paysages dans le sens inverse. J’aime les tournants secs entre les séquoias, et je retombe enfin dans la chaleur lourde du piémont d’herbes jaunes, avec une rivière qui coule fort. Il n’y a pas de bon endroit pour camper. Tout est soit trop pentu, soit de la propriété privée enceinte de barbelés. Je pousse vers Springville. Je m’arrête pour regarder ma carte près des boîtes aux lettres du quartier. Dans les zones rurales, les boîtes aux lettres sont parfois toutes situées à un même endroit pour faciliter la distribution. Une femme en voiture vient chercher son courrier. Je lui demande où je puis camper et elle m’invite à son ranch, après m’avoir demandé si je ne suis pas « un tueur à la hache ». J’hésite curieusement à la question : c’est bien la première fois qu’on me juge une hypothétique source de danger et non une éternelle victime potentielle. Elle et son mari vivent sur un très beau ranch où ils élèvent du bétail et font pousser du blé. Depuis cinq ans, ils ont également planté des noisetiers et des pacaniers, qui résisteront mieux aux sécheresses futures qui menacent la Californie. Je suis invitée au dîner de famille. Tous sont bienveillants. La nièce de Sara me présente sa fille adolescente, qui est non-verbale, et je lui prends les mains en lui complimentant ses yeux : ils sont d’un bleu vert magnifique, avec des taches d’ambre. Le repas est servi dans cette tradition américaine où toute la nourriture est présentée en buffet où l’on va se servir avant d’aller se mettre à une table commune ou manger en restant debout. Avant de se servir, nous nous tenons les mains en cercle et ils adressent une prière pour remercier leur dieu. Au cours du repas, ils se remémorent leurs parents et leurs amis qui ne sont plus, et l’un d’entre eux, âgé, se réjouit d’ imaginer une proche maintenant au ciel avec les anges, libérée de sa douleur terrestre. Je suis touchée de voir la candeur avec laquelle l’idée d’une vie après la mort, et d’une réjouissance dans l’au-delà, lui apporte sérénité et lui ôte la tristesse existentielle que l’on a au creux de soi quand on ne croit qu’au néant. Sara est douce avec moi, me disant que si sa fille de 26 ans était dans ma situation, elle aime à croire qu’il y a des gens qui prendraient soin d’elle comme un parent. Partout, les mères voient dans les jeunes femmes leurs filles. Je dors comme une souche dans ma tente, placée au fond du champ sur le chemin de terre, car Don m’a mis en garde contre les hautes herbes (« winter grass ») et les serpents à sonnettes qui y nichent nombreux. Dans la nuit, j’entends glouglouter les dindons.
28 avril
Je pars à 7 h, après avoir remercié Sara à nouveau. Je traverse le piémont de collines sèches qui me rappelle à présent le Pays de Galles, avec des ranchs et des vaches, mais où au fond des vallées plates il niche des vergers avec des orangers. Tous les paysages que je croise depuis quelques jours en appellent d’autres, car l’esprit adore faire des liens et trouver de la familiarité là où il n’y a qu’une ressemblance vague. On voit les montagnes claires de granit nu au fond. Je monte progressivement vers elles, sur un doux faux-plat. Une grande faim me prend et je m’arrête à une station-service. J’achète un burrito frais : fromage, haricots et riz. À la première bouchée, je sens un goût de bœuf. Le burrito en est à demi plein. Aux tenanciers, je fais part de ma déception froide d'avoir été trompée. Je jette le burrito et, pour combler ma faim, achète un gâteau sucré. Ils ne me font pas payer le gâteau. Je passe par un beau lac qui me fait oublier le goût du bœuf, et la montée se fait plus pentue. Je m’arrête un instant en ville pour acheter des provisions. La chaleur se lève. J’atteins un péage. Je comprends alors la différence entre National Park et National Forest. National Forest désigne un espace protégé. Les National Parks sont ces Disneyland naturels, à l’entrée payante, avec un flux constant de camping-cars et de voitures de location, conduits par des touristes américains ou étrangers qui prennent des photos tout en conduisant. Je sue au soleil dans la queue du péage entre tous ces véhicules. L’entrée est hors de prix pour les cyclistes. J’ai un souvenir amer de Yellowstone et combien j’avais détesté cet endroit. Au centre d’informations, une femme désagréable me prévient que les rangers veillent en patrouillant, à ce qu’on n'y campe pas illégalement et qu’en même temps, les emplacements des campings officiels sont réservés aux véhicules à moteur. Par dépit, je lui annonce qu’alors je traverserai tout le Park aujourd’hui et camperai au sommet de la montagne, dans la National Forest. La ranger me dit que le sommet est trop haut et que je n’y arriverai pas. Cela attise mon ardeur à faire les 3000m de dénivelé tout de go et à quitter ces lieux.
La route est dangereuse, les conducteurs de camping-car de location n’ont pas conscience de la largeur des véhicules, et certains me frôlent. L’aspiration me pousse de leur côté à parfois m’en faire un peu perdre l’équilibre. L’endroit est tout de même magnifique. Je grimpe des vallées aux cascades et aux larges éboulis brûlants jusqu’aux neiges. Je trempe régulièrement mon t-shirt dans les cours d’eau pour me maintenir au frais sous le soleil. J’atteins des lacets avec une vue magnifique. Vers 1600m, j’entre dans une forêt de séquoias géants. Je fais une petite sieste dans un cul-de-sac isolé avant de repartir. Les touristes ne s’aventurent pas au-delà des bords de route. Entre les arbres, il reste des petits tapis de neige de l’hiver. Au fur et à mesure de mon ascension, le manteau neigeux se fait de plus en plus épais. Voici une chose à laquelle je n’avais pas pensé : trouverais-je un endroit sans neige pour camper ce soir ? La neige atteint parfois dans les creux au pied des racines des hauteurs d’un mètre cinquante. Les cascades coulent fort de leurs fontes.
J’atteins le sommet à 2300m. Tout le paysage est couvert de neige. Il y a des bâtiments, un centre touristique avec une supérette, eux aussi recouverts. Le magasin était en train de fermer, j’y demande à une femme si la neige est moins épaisse dans la forêt en contrebas. La femme, Diane, me propose alors de dormir avec elle et sa partenaire, dans leur cabane des employés du Park. J’avais plusieurs fois vu ces drôles de camps de cabanons cachés dans les recoins des parcs nationaux. Je sprinte derrière sa voiture, et cela achève de me fatiguer. Il y a encore de la neige partout. La cabane fait la taille d’un wagon coupé en deux, avec à peine la place pour deux lits une place, un comptoir avec un micro-onde et un petit placard de rangement. Tout est entreposé dans des étagères au plafond. Je prends un des lits qu’elles m’offrent volontiers. La cabane n’a pas l’eau courante, les douches sont dans un bloc sanitaire et il faut affronter le froid pour les atteindre, même en hiver. Diane et Janice ont un pot de chambre dans leur cabanon. La nouvelle de mon arrivée s’est vite propagée dans le camp, et des hommes sales, bourrus et saouls, viennent se présenter à moi. Les travailleurs forestiers, cachés derrière les rangers en bel uniforme, sont des hobos modernes, certains sortis de prison, d'autres probablement la fuyant, hébergés dans ces camps de travail dans des conditions honteuses. Mon vélo passe la nuit dans la cabane d’un jeune, pour éviter les vols. Diane me fait comprendre que certains de ces hommes sont dangereux. Je m’habitue à voir dans la cabane pleine d’objets aux murs les éléments uns à uns, et je vois ce qu’ils portent de tendresse en eux. Janice est couturière, elle fait des quilts magnifiques, d’une complexité remarquable. Elles parlent de leur famille et de leurs enfants. Je dors bien. Le lendemain, avant de partir, nous échangeons avec Diane nos casquettes : je lui donne ma casquette promotionnelle d’un magasin de photo de Londres et elle me donne la sienne, estampillée de « Sequoia National Park ».
29 avril
Je descends des hauteurs et je vois les nuages de pluie parcourir la vallée en contrebas. Lors de mes rêveries, ceci m'apparaît soudainement comme une évidence : il y a bien longtemps que je n’avais pas rencontré de dieux dans la forêt, et voilà qu’ils s’étaient présentés à moi à nouveau, sous une autre forme, et que je ne les ai même pas reconnus. Car n’était-ce pas Diane qui m’a pris sous son toit ? Elle m’a accueilli, m’a protégé et éloigné les satyres de son courroux. Et j’ai dormi à côté d’elle et d’une de ses nymphes. Elle reconnaît les siennes parmi celles qui parcourent les montagnes. Notre monde est vieux, et même si les dieux sont immortels, Diane n’y est probablement plus une jeune chasseresse, mais cette mère aimant les femmes, vivant dans la forêt parmi ses créatures. Quel honneur, d’être reconnu par la déesse Artémis même, et je continuerai à faire honneur à ses valeurs en vivant une vie de tendresse, de colère, et d’une gloire silencieuse.
Je passe par Kings Canyon. Les séquoias y sont prestigieux. Mes jambes et leurs muscles sont douloureux du sprint de la veille, je les sens comme prêts à se déchirer. Je m’arrête à Grant Grove. J’y discute avec deux bikers. L’un d’eux a un regard fort, au coin d’yeux plissés, il me fait penser à Clint Eastwood. Il me dit que sa femme étudie le français comme hobby depuis dix ans. Je lui conseille des livres à lui acheter, et il s’illumine à cette idée : il n’y avait pas pensé.
Je prends des petites routes qui me ramènent dans le piémont par des collines et campe à Pine Flat Lake. Beaucoup de la journée est en descente, je n’ai pas à forcer sur mes jambes fatiguées. Je repasse les paysages de la veille, pins et séquoias, neige et éboulis, décidieux et pins, herbes vertes, buissons et décidieux, puis enfin herbes hautes jaunes et lacs. Je m’étire plusieurs fois dans la journée. Le lac semble avoir un niveau bas, mais c’est peut-être que la ligne des arbres est étrange, formant une couronne à quatre mètres au-dessus de l’eau. Je mange beaucoup. Je rencontre un couple d’anglais en voyage. Je discute avec la femme qui me dit, qu’à la veille de ses 30 ans, elle s’est rendu compte qu’elle n’avait jamais rien fait d’aventureux de sa vie, et ce voyage est sa première aventure. Je vois aux plis de sa bouche et de ses yeux des premiers signes d’âge, qui apparaissent si vite à cet âge-ci, et cela m’attendrit autant que cela me fait un peu peur, car je sais que ces plis apparaîtront sur mon visage, et je pense que je ne les verrai pas : on ne les voit pas sur son propre visage.
30 avril
Mes jambes ne sont toujours pas remises. Je roule doucement toute la journée. Je reste dans le piémont de la Sierra Nevada. Les collines sont nombreuses et sèches. Je m’arrête à North Fork pour un café et je discute plus d’une heure avec la barista, Cassandra. Elle est ex-mannequin et a ouvert ce café il y a quelques années. Elle me parle du lien entre le libéralisme américain et la mentalité américaine. J’apprends beaucoup de choses. Il est rare aux États-Unis d’entendre un discours critique modéré et censé, et non un discours d’opinion. Est-ce là une nouvelle rencontre prophétique ? Cassandra, fille d’Hécube, maudite par Apollon, qui prédit l’avenir sans jamais n’être crue. Je me creuse la tête en repartant, repassant notre conversation pour tenter d’y déceler un mystère. La malédiction est en effet bien forte : je ne trouve rien.
Il y a de belles maisons à Bass Lake. Le ciel est bas et humide, mais il ne pleut pas. Je passe par Oakhurst et rejoins une National Forest pour camper. La dernière montée me fatigue fort. Je retrouve les hauts arbres. Je discute avec des gens en chemin, des locaux qui reviennent de randonnée. Ils me racontent qu’en poursuivant la route de terre vers les sommets, on peut rentrer dans Yosemite en contournant les péages. Un panneau en début de route indique aux véhicules cherchant à rentrer dans le Park à ne pas suivre leurs GPS et à faire demi-tour. Les randonneurs me disent en riant que chaque année des camping-cars ignorent l’avertissement et que leur jeu consiste, lorsqu’ils en voient un monter la route, à prendre des paris sur le temps qu’il faudra avant qu’une dépanneuse ne monte la route à sa suite. Je continue l’ascension et dors dans une zone d’abattage. J’ai cru trouver un endroit plat, et à peine dans ma tente, je glisse en roulant d’un côté. Ma nourriture est pendue dans un arbre : il doit y avoir des ours noirs dans la région.
1er mai
La première aube du plus beau mois. Je suis la route 49 sur les hauteurs. Les nuages sont diffus. Je prends un café à Mariposa, puis vais à Sonora. Je descends à nouveau dans les collines d’herbe jaunes. J’achète des chaussures bon marché. Demain, je rejoins Dylan à Volcano.
2 mai
C’est la Sainte Zoé. Je roule doucement. Mes jambes sont toujours aussi fatiguées. Cela me fera du bien de me reposer. J’attends Dylan au bar de Volcano avec une bière et j’écris ce carnet. Le village est charmant. Les treillis sont fleuris. Je suis dans une petite Bourgogne californienne. Dylan entre et s’assoit sur la chaise à côté de moi en disant « What’s up ? » Cela faisait trois ans que nous avions voyagé ensemble en Alaska. Je mets mon vélo à l’arrière de son pick-up et nous allons à Lake Tahoe le soir, en passant par des cols enneigés dans la nuit.
3,4,5,6 mai
Elmo le chien, tirer à la carabine du balcon, le Tittie Wagon, sa jarre de cannabis, des champignons autour du lac sur des beach cruisers, aller dans les casinos à Reno, The Grateful Dead, manger au drive-in, du half and half, une tempête qui emporte son essuie-glace, James Brown, traverser le désert du Nevada, aller camper, les sources thermales, des lézards étranges, du surf rock chez ses potes, nous demander dans les rues de Reno si l’amour ne nous manque pas. Le 6 mai je dors chez sa pote Jamie à Reno, et je prends le train le lendemain pour San Francisco. Mon vol approche.
7 mai
J’écoute du rap français de mon enfance dans le train (Sinik ?). Je vois brièvement San Francisco. D’ici, je n’ai plus qu’à descendre jusqu’à Los Angeles rejoindre Gabriel.
8,9,10,11 mai.
Je descends la côte Ouest. La route est ennuyeuse. Je croise quelques cyclistes. Beaucoup en sont à leur premier voyage à vélo et leur enthousiasme en est contagieux. Ils me demandent des conseils, partagent leurs craintes. Je campe à Big Sur et rencontre un Français débarqué en stop. Il est mignon, et cela fait si longtemps que je n’ai pas parlé français que cela me donne un peu le mal du pays. Le lendemain, je me réveille un peu nostalgique. Je repense à l’homme qui me mit en garde contre les « homeless who defecate in the woods ». Cela me paraît déjà si loin ! Sur un bas côté de la route, je vois un lynx. Il est petit, sûrement malade, pour être ainsi en plein jour assis en bord de route. Je m’empêche de toute ma volonté de l’approcher.
Le dernier soir avant Santa Barbara, je rencontre dans un camping où sont de nombreux cyclistes un homme odieux. Il est hautain, fort d’un orgueil sans limite. Son vélo est chargé d’une guitare et d’une machette. Je lui demande ce qu’il compte faire de la machette. Il dit qu’il en aura besoin, s’il va en Alaska. Il prononce ce mot avec un mystère. Je me garde de lui dire que j’ai parcouru ce chemin et qu’il n’y aura nullement besoin de machette. Un autre cycliste parle des nuits d’orages qu’il a dû supporter. L’homme odieux répond : « Je dors sous la pluie, je me fiche de la pluie, j’aime sentir la pluie sur mon visage ». Je regarde dubitativement sa MSR qu’il a mise sur un tapis de sol supplémentaire, sur un endroit parfaitement lisse. Il est tellement imbu de lui-même que nous sommes plusieurs à en être énervés et à nous jeter des regards avant de nous éloigner de lui. Mon énervement est tel que, alors que je tente de réparer un bouton de mon téléphone, je le brise entre mes mains. L’écran ne fonctionne plus qu’à moitié. Il s’éteint plusieurs fois. J’envoie un message à Gabriel pour lui dire que mon téléphone se meurt.
Je rejoins Gabriel à Santa Barbara, nous mangeons un burrito et mettons mon vélo à l’arrière de sa décapotable rouge, et partons, musique à fond, direction Los Angeles.